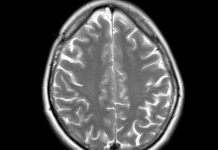Africa-Press – Togo. Fondé en 1667 par l’Académie royale des sciences sous l’impulsion du roi Louis XIV, l’Observatoire de Paris (appartenant au réseau universitaire Paris Sciences & Lettres) fait partie des centres de recherche de référence dans les domaines de l’astronomie et de l’astrophysique françaises. Il explore diverses thématiques, allant de l’étude des corps mineurs comme des astéroïdes ou comètes jusqu’aux lointaines exoplanètes (planètes situées en dehors du Système solaire).
Le 14 octobre 2025, les chercheurs du campus de Meudon de l’Observatoire de Paris ont montré les installations NAROO (acronyme en anglais de « New Astrometric Reduction of Old Observations ») à la presse. Il s’agit d’un instrument de pointe unique en Europe qui permet de numériser des plaques photographiques représentant des observations effectuées entre 1890 et 1998 de corps célestes de tous types, incluant des planètes, satellites naturels, astéroïdes, galaxies, etc.
Un trésor d’archives astronomiques
La visite des installations NAROO est précédée de brèves conférences mettant en lumière l’historique des plaques de verre photographiques, dont les premières furent réalisées à l’Observatoire Royal de Greenwich, à Londres, où 100.000 d’entre elles sont répertoriées. La sélection des plaques a commencé en 1887 lors du Congrès Astrophotographique International, organisé à l’Observatoire de Paris. D’après Valéry Lainey, astronome au LTE (Laboratoire Temps Espace) et co-organisateur de l’événement avec Louise Devoy, curatrice de l’observatoire britannique, il y aurait plusieurs centaines de milliers de ces clichés photographiques dans le monde.
Une telle collection patrimoniale rend compte de la collaboration scientifique franco-britannique effective malgré le contexte post-Brexit. Il est important de noter que les plaques photographiques ont été transférées à de multiples reprises: gardées à Greenwich de 1890 à 1990, en plus des documents associés comme des inventaires, étiquettes ou tirages papiers stockés à la bibliothèque de l’université de Cambridge depuis 1998 et quelques centaines de milliers de plaques se trouvant à la bibliothèque de Bodley d’Oxford depuis 2013.
Durant la tenue de l’avant-dernière conférence, donnée par Carl D. Murray, enseignant-chercheur de mathématiques et d’astronomie à l’université Queen Mary de Londres, la plaque photographique de la découverte de Pasiphaé (lune de Jupiter) datant de 1908 est montrée pour illustrer la précision de la numérisation des plaques, équivalente à celle des sondes spatiales comme Cassini ou Voyager. Bien que de nombreux instituts de recherche soient dédiés à la préservation et l’archivage de matériel historique, le programme NAROO (projet crée en 2013 et devenu un programme d’investigation scientifique à partir de 2020) entend mener sa mission dans un but purement scientifique, cherchant notamment à améliorer et compléter les connaissances sur la dynamique des astres, apportant un complément à la mission Gaia.
Cette branche de l’astrophysique s’attache à décrire, puis à prédire avec précision les trajectoires des corps célestes, tout comme l’a fait la mission de l’Agence spatiale européenne (ESA), Gaia, entre 2013 et janvier 2025. Cette mission astrométrique (mesure des positions des astres) majeure a permis en outre de recenser les positions dans le ciel via les coordonnées célestes que sont l’ascension droite et la déclinaison, les distances au Système solaire et les orbites de près de deux milliards d’étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée, traçant une cartographie grandeur nature d’un vaste « zoo » stellaire.
Photographie de Pasiphaé (indiquée en zoomant sur le VIII), lune de Jupiter, en 1908 par l’Observatoire Royal de Greenwich et numérisée par l’Observatoire de Paris. Crédits: Vincent Robert
Valorisation de la contribution majeure des femmes en astronomie
Par ailleurs, l’existence de cette myriade d’archives d’astrométrie permet de mettre en valeur la contribution des femmes dans le domaine scientifique, comme l’évoque Louise Devoy dans l’introduction de l’événement meudonnais en mentionnant les « Lady Computers », notamment les chercheuses Alice Everett (1865-1949) et Annie Scott Dill Russel (1869-1947), premières femmes salariées de l’Observatoire royal de Greenwich dans les années 1890. Elles étaient chargées de mener les calculs astronomiques et de traiter les données recueillies. Ces dernières peuvent être d’ailleurs assimilées aux « calculatrices » de la Nasa. Ces figures de l’ombre (dont l’histoire est relatée dans le film éponyme de 2016) ont contribué au succès des missions orbitales et spatiales des années 1950 et 1960, incluant entre autres les programmes Mercury (premier vol d’Alan Shepard en avril 1961) et Apollo (missions lunaires).
Alice Everett, pionnière des observations astronomiques au Royaume-Uni
Née le 15 mai 1865 à Glasgow (Ecosse), Alice Everett est l’une des rares étudiantes à pouvoir effectuer des études de mathématiques au Girton College de l’université de Cambridge à partir de 1886. Elle apparait comme l’une des premières figures féminines de l’Observatoire Royal de Greenwich et participe activement à la mesure et à l’analyse des plaques photographiques, essentielles pour déterminer les positions exactes des astres. Son travail minutieux de réduction des observations a permis d’affiner les catalogues stellaires utilisés à l’époque pour la navigation et les calculs d’éphémérides. En tant que « Lady Computer », elle incarne ces chercheuses de l’ombre sans qui la cartographie céleste moderne — aujourd’hui symbolisée par des missions dédiées comme Gaia — n’aurait probablement jamais vu le jour.
NAROO: restaurer le passé astronomique avec précision
Après l’ensemble des interventions scientifiques, Sciences et Avenir a eu le privilège de visiter les installations NAROO, où Vincent Robert, astronome à l’Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA) et au Laboratoire Temps-Espace de l’Observatoire de Paris-PSL, nous montre (dans la vidéo ci-dessous) les coulisses derrière la machine imposante d’une masse de deux tonnes. Bien que NAROO soit un instrument pesant avec une précision sub-micrométrique (en dessous du millionième de mètre, soit l’épaisseur d’1/100ème de cheveu), elle ne rivalise pas avec la précision du satellite Gaia, qui est mille fois plus grande, mais sur un intervalle de quelques années seulement.
Selon le chercheur, NAROO présente des mesures d’une qualité certes modeste vis-à-vis de la mission européenne, mais évidemment complémentaire, car le programme présente l’avantage de se dérouler sur un temps considérablement plus long de près d’un siècle, ce qui rend compte d’une prodigieuse richesse scientifique, patrimoniale et l’acquisition d’un grand nombre de données acquises. De plus, Gaia étant un satellite situé dans l’Espace, il n’est pas, contrairement à l’instrument NAROO, impacté par l’effet de turbulence atmosphérique, qui agit comme un parasite d’images, notamment en raison de la couverture nuageuse variable, de la pollution urbaine et l’agglomération de satellites pouvant entraver les observations.
Visite des installations NAROO avec l’astronome Vincent Robert. Crédits: Emilie Proumen
L’ambition de scanner des centaines de milliers de plaques de verre représente alors un défi titanesque: au moins 2 500 plaques astrophotographiques sont analysées tous les six mois, ce qui prendrait au moins 20 ans pour numériser l’ensemble des archives de Greenwich par exemple, comme le fait remarquer Vincent Robert. Une fois que les plaques sont numérisées, on peut admirer des millions de points lumineux sous formes de pixels et les données accumulées sont comparées avec les catalogues de référence, comprenant notamment celles de Gaia, constituant des mesures astrométriques précieuses pour étayer notre compréhension des mouvements des astres.
En outre, concernant l’avenir des mesures astrométriques, Vincent Robert imagine une amélioration des caméras des différents instruments, dont une application pourrait être de comparer les champs de profondeur d’images pour détecter des objets interstellaires, catégorie de corps célestes dont font parties 1I/Oumuamua, 2I/Borisov et 3I/ATLAS, respectivement observés en 2017, 2019 et 2025. Ce type de tâche pourrait être particulièrement adaptée pour l’intelligence artificielle (IA), assurant une rapidité d’exécution, bien qu’encore considérée comme imparfaite et sujette à des améliorations.
Cartographie en couleurs de la Voie lactée et des galaxies voisines basée sur l’observation de 1,7 milliard d’étoiles par le satellite Gaia, montrant chaque portion du ciel entre juillet 2014 et mai 2016.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Togo, suivez Africa-Press