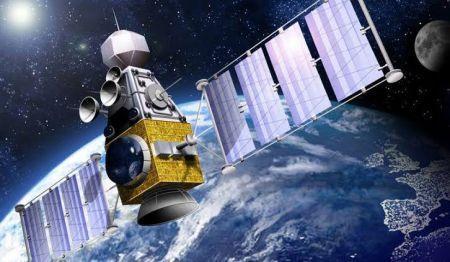Africa-Press – CentrAfricaine. Les programmes spatiaux africains s’affirment comme un moteur de croissance et d’innovation. Mais entre promesses économiques et contraintes budgétaires, l’équation reste délicate: comment transformer la conquête de l’espace en retombées concrètes pour les populations.
Depuis quelques années, satellites et programmes spatiaux sont devenus des outils concrets de sécurité, de connectivité et de développement en Afrique. Selon un rapport du Centre africain d’études stratégiques (ACFSS), daté du 9 septembre 2025, les États africains consacrent environ 500 millions de dollars par an à leurs programmes spatiaux. Un chiffre élevé pour un continent encore confronté à des défis de pauvreté, d’éducation et de santé. Mais derrière ces investissements se cachent des enjeux stratégiques majeurs: souveraineté, résilience, et place dans l’économie numérique mondiale. Parmi les leaders du spatial, figurent l’Égypte, l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc, l’Algérie et l’Angola, qui ont tous réalisé des investissements soutenus dans le domaine. Leurs programmes englobent à la fois des satellites d’observation de la Terre, de communication et scientifiques, souvent soutenus par des partenariats internationaux. L’Afrique du Sud collabore même avec la NASA dans le cadre du programme Artemis, qui vise le retour sur la Lune et l’exploration de Mars.
Le continent compte plus de 120 satellites supplémentaires en cours de développement, dont le lancement est prévu d’ici 2030. L’ACFSS indique qu’à l’heure actuelle, plus de 21 pays africains ont mis en place des programmes spatiaux et 18 ont lancé au moins un satellite. Le continent a lancé un total combiné de 65 satellites (y compris des CubeSats).

Quand la technologie rencontre le quotidien
Pour beaucoup de gouvernements africains, l’espace n’est pas un luxe, mais une nécessité. Les satellites offrent plusieurs cas d’usage: ils permettent de surveiller les frontières, lutter contre le terrorisme, la contrebande et la pêche illégale. Ils offrent une visibilité inédite sur des territoires immenses et parfois difficiles d’accès, où les patrouilles terrestres se révèlent inefficaces. En mer, les satellites deviennent les gardiens des zones économiques exclusives africaines, pillées depuis des décennies par des flottes étrangères. Sur terre, ils aident à suivre l’exploitation illégale des mines et des forêts. Même la protection de la faune bénéficie de colliers géolocalisés par satellite pour lutter contre le braconnage. Dans des économies où l’agriculture occupe souvent la majorité de la population active, l’espace s’impose comme une révolution silencieuse. Les satellites fournissent des données climatiques et agricoles: prévisions de pluie, suivi de l’humidité des sols, cartographie des cultures. Ces informations permettent d’augmenter les rendements et de réduire les pertes. Dans un continent régulièrement frappé par les sécheresses et les inondations, la capacité d’anticipation devient vitale. L’agriculture de précision, alimentée par des images satellites, n’est plus une abstraction futuriste, mais une pratique déjà en cours au Kenya, au Nigeria ou en Afrique du Sud.
Les satellites alimentent aussi des usages civils quotidiens: télévision, GPS, téléphonie mobile, et surtout Internet haut débit dans les zones rurales. Là où la fibre optique ne peut pas arriver, le satellite comble le vide, connectant écoles et centres de santé isolés. La pandémie de COVID-19 a rappelé l’importance de ces outils: les services d’enseignement à distance et de télémédecine se sont appuyés sur des réseaux satellitaires pour atteindre des populations autrement déconnectées. En mars 2024, lors de la rupture de câbles sous-marins de fibre optique dont l’effet a été une perturbation des services internet pendant de nombreux jours dans 13 pays d’Afrique de l’Ouest, les services satellitaires tels que Starlink et NigComSat au Nigeria ont fourni une connectivité alternative, soulignant l’importance stratégique des réseaux spatiaux.
Mais les dépenses annuelles engagées ces dernières années dans les satellites suscitent des débats. Les critiques dénoncent des programmes redondants et coûteux, dans des pays où les besoins sociaux restent immenses. En effet, le risque de « prestige spatial » n’est pas absent: certains gouvernements veulent prouver leur modernité en lançant leurs propres satellites, alors que des solutions plus économiques existent, comme l’achat de données à des plateformes commerciales indique l’ACFSS. Le Rwanda, par exemple, a choisi de centraliser l’accès à ces données plutôt que de multiplier les lancements, e concentrant ses ressources financières sur plusieurs cas d’usage pratiques.

Pour éviter cette dispersion, l’Union africaine a inauguré en avril 2025 l’Agence spatiale africaine (AfSA), basée au Caire en Egypte. Sa mission: harmoniser les stratégies nationales, favoriser les missions conjointes, mutualiser les coûts, négocier des partenariats internationaux et veiller à ce que les activités spatiales soutiennent directement la vision de l’Agenda 2063 de l’Union africaine pour un continent prospère et intégré. Des initiatives comme l’African Development Satellite Initiative (AfDev-Sat), portée par l’Égypte, illustrent aussi ce potentiel de collaboration. Le programme a déjà formé 71 ingénieurs venus de 34 pays et ouvert ses installations d’assemblage, d’intégration et d’essai de satellites à ses partenaires africains. En parallèle, l’AfSA pilote le Partenariat spatial Afrique–UE, doté de 100 millions d’euros par l’Union européenne, pour renforcer les capacités africaines en matière de surveillance du climat, d’agriculture, de gestion des risques de catastrophe et de développement du secteur privé, tout en garantissant la maîtrise par l’Afrique des données et des systèmes qu’elle génère.
Une nouvelle géopolitique des étoiles
Selon l’ACFSS, l’espace africain attire aussi les grandes puissances. La Chine, la Russie, les États-Unis et l’Europe voient dans cette nouvelle frontière un terrain d’influence. Pékin finance et construit des satellites pour plusieurs pays africains, tandis que Moscou a lancé Angosat-2 pour l’Angola. L’Europe mise sur la coopération technique, et Washington intègre déjà l’Afrique dans ses programmes lunaires. Cette compétition crée des opportunités, mais aussi des risques: dépendance technologique, endettement, ou perte de souveraineté si l’Afrique ne définit pas ses propres priorités.
Pour les défenseurs des investissements dans des satellites africains, l’espace est un outil de survie autant qu’un pari sur l’avenir. Sécurité, agriculture, climat, éducation, connectivité. Rares sont les domaines qui n’en dépendent pas. À long terme, ne pas investir reviendrait à laisser d’autres le faire et accentuer la dépendance de l’Afrique aux infrastructures technologiques étrangères. Pour les critiques, la prudence est de mise. Les 500 millions de dollars investis par an pourraient aussi financer des hôpitaux, des routes ou des universités. Le défi est donc d’assurer que chaque dollar investi dans l’espace ait un retour concret sur la vie des citoyens.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la CentrAfricaine, suivez Africa-Press