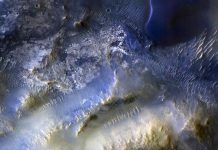Mathieu Galtier
Africa-Press – CentrAfricaine. Les groupes régionaux se sont durablement installés dans le paysage financier du continent. Ils doivent maintenant monter en gamme pour bénéficier à plein d’un environnement favorable mais fragile.
Jusqu’ici tout va bien. Contrairement au film culte La Haine, de Mathieu Kassovitz, aucune ironie dans ce constat, concernant les groupes financiers panafricains. L’année écoulée a ainsi montré la capacité des banques régionales francophones à se développer et à continuer d’occuper la place vide laissée par le départ des banques de détail européennes. Sur les cinq accords de cession des filiales de Société générale – 6e banque européenne, avec 1 719 milliards de dollars d’actifs – signés ces derniers mois, seule l’entité malgache, reprise par la banque française Bred, a échappé à un groupe africain. La plus grosse part du gâteau, SocGen Maroc, est allée, en avril 2024, à un nouveau venu de poids: l’ancien ministre marocain Moulay Hafid Elalamy, qui a déboursé 745 millions d’euros pour faire partie du club des banquiers continentaux. Preuve que le marché attire.
Même effervescence en Afrique anglophone. En novembre, le groupe britannique Standard Chartered, 14e banque du Vieux Continent avec 828 milliards de dollars d’actifs, a évoqué la possibilité de vendre ses filiales au Botswana, en Ouganda et en Zambie. Aussitôt, l’établissement nigérian Access Bank s’est dit intéressé. Quelques mois plus tôt, le leader bancaire d’Afrique de l’Ouest dirigé par Roosevelt Ogbonna avait déjà acquis les filiales en Angola et en Sierra Leone, et est en passe d’ajouter celles du Cameroun, de la Gambie et de la Tanzanie à son escarcelle. Le géant pourrait même débarquer au Maroc.
Banques sans frontières
La consolidation de ces groupes tend d’ailleurs à effacer les distinctions régionales sur le secteur. Au Sénégal, la Compagnie bancaire de l’Afrique occidentale (CBAO), filiale du marocain Attijariwafa Bank, est la première banque du pays après le retrait de Société générale. En sens inverse, le kényan Equity Bank est le deuxième établissement financier en RD Congo. Le Togolais Ecobank est, lui, présent dans 33 pays du continent, avec 96 % de ses actifs se trouvant en dehors de son pays de résidence, et un principal actionnaire venu d’Afrique du Sud, Nedbank. Essentiellement soutenu par les banques centrales des pays de la zone ouest-africaine (UEMOA), le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), porté par Afreximbank et le secrétariat général de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), a vu arriver le renfort, en mars, des plus importantes banques du Kenya, KCB, et du Rwanda, Bank of Kigali.
Le secteur est également porté par la mise à niveau des pôles bancaires chez les assurbanques, ou bancassurances, francophones. Le temps est à l’« expansion bancaire », affirmait en fin d’année Léonce Yacé, directeur général adjoint du groupe ivoirien NSIA. Il promet l’ouverture d’une à deux succursales bancaires par an jusqu’en 2027 pour rééquilibrer les deux métiers. « Notre volonté, c’est de proposer à nos clients une démarche commerciale unifiée. Nous devons pouvoir lui proposer l’ensemble des produits et services, assurance et banque, du groupe », promet le bras droit du fondateur, Jean Kacou Diagou.
Pour cela, NSIA, comme son concurrent Sunu ou encore Afriland First Group, compte sur l’entrée en vigueur, depuis le 1er janvier, d’un nouveau règlement dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) qui facilite l’obtention de l’agrément unique des établissements de crédit. Les banques qui n’ont pas encore franchi le pas s’apprêtent à entrer en Bourse, autant pour renforcer leur capacité de financement que pour se conformer à une transparence financière, exigée aux grands établissements à travers le monde. C’est notamment le cas de la BGFIBank au Gabon, dont le groupe est incontournable dans la région Cemac.
Les banques africaines n’ont plus de frontières, elles n’ont que des opportunités. « Il existe encore des opportunités de rachat, je pense notamment à quelques banques nationales comme l’UTB [Togo], la SIAB [Togo] ou encore la BIIC [Bénin], mais le mouvement va ralentir à court et moyen terme », précise Jean Didier Attingli, chef du bureau togolais de la société de gestion Africabourse.
Coût financier et social
Après le départ en canon des groupes régionaux, favorisé par le repli des banques occidentales (Société générale, BNP Paribas, BPCE, Standard Chartered, etc.), le temps est venu de se positionner au mieux à l’entrée du premier virage, celui de la consolidation. Selon la Banque africaine de développement (BAD), la moitié du continent devrait connaître une croissance supérieure à 5 %, et douze des vingt économies à la croissance la plus rapide au monde seront africaines. Le marché bancaire ferait encore mieux. Au Maroc, les banques pourraient atteindre 13,5 % de croissance. En Afrique du Sud, la hausse des crédits au secteur privé tournerait autour de 8 % – 9 %, selon S&P Global. De quoi attirer les investisseurs, d’autant que cette progression n’est pas près de s’arrêter.
Le taux d’inclusion financière n’était que de 55 % en Afrique subsaharienne en 2021, mais il était de 23 % à peine dix ans plus tôt, d’après la Banque mondiale. Il reste donc beaucoup à faire, et la tendance s’accélère grâce au numérique: « Les entreprises de technologie financière africaines se sont considérablement développées et améliorent l’accès au financement. La proportion des personnes titulaires d’un compte d’argent mobile en Afrique subsaharienne a presque triplé au cours des sept dernières années », constate le dernier rapport de la Banque européenne d’investissement sur la finance en Afrique.
Paiement par application, par SMS, par QR code, toutes les solutions existent sur le continent. Mais dans les back-offices des banques régionales, cela nécessite un coût financier et social important. Le rachat d’une filiale ne s’arrête pas à la signature du chèque: le nouvel acquéreur doit imposer sa culture d’entreprise, et surtout son système d’information, qui couvre aussi bien les solutions pour les clients (application mobile notamment) que les logiciels utilisés par les banquiers, le tout devant se conformer aux réglementations de plus en plus pointilleuses des régulateurs en termes de protection de données et de compliance. « D’ici cinq ans, la zone UEMOA aura intégré les normes Bâle II et Bâle III », prédit ainsi Paul-Harry Aithnard, directeur général UEMOA à Ecobank.
Facteurs exogènes
Des normes qui prévoient notamment une traçabilité quasi instantanée des opérations par les régulateurs. Sunu, référence dans la bancassurance en Afrique subsaharienne, a décidé, par exemple, de créer une filiale, Sunu DigiTech, dirigée par Roch Guinko, pour la mise en conformité technique aux nouvelles règles. Bernard Koné Dossongui, fondateur d’AFG, a préféré passer par des experts extérieurs, le cabinet OnePoint et la Société financière internationale (IFC, groupe de la Banque mondiale). L’instabilité politique et la soudaine propension des puissances publiques à se muer en banquier en rachetant des banques à vendre sont autant de facteurs exogènes qui pourraient affaiblir le secteur.
Ces rachats sont des changements radicaux pour ces acquéreurs, ils prennent le relais de banques internationales. Cela prend du temps, mais, indéniablement, cela favorisera la consolidation de ces grands groupes bancaires régionaux.
Une mutation profonde qui ne va pas sans heurt social, dû au changement de culture d’entreprise et à la rationalisation des effectifs induits par la numérisation de nombreuses tâches. « »Ces rachats sont des changements radicaux pour ces acquéreurs, ils prennent le relais de banques internationales. Cela prend du temps, mais, indéniablement, cela favorisera la consolidation de ces grands groupes bancaires régionaux », admet Jérôme Ehui, président de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d’Ivoire. Les États subsahariens, toujours plus endettés, trouvent dans ces grandes banques des créanciers bienvenues pour leurs Bons du Trésor et ainsi substituer, autant que possible, la dette extérieure à une dette intérieure plus gérable.
Des signaux au vert
Des freins, mais certainement pas des obstacles pour ces banquiers qui sont là pour jouer dans la cour des grands. En début d’année, Vista Bank Group a obtenu le feu vert des autorités de Paris pour ouvrir des agences en France. Pour Simon Tiemtore, son dirigeant, il s’agit de prendre part sur des secteurs jusqu’ici réservés aux banques occidentales, comme la correspondance bancaire et la levée des capitaux sur le marché international. Une ambition que tous les groupes panafricains ont, mais qui est encore loin d’être une réalité.
L’architecture de la finance africaine n’est pas encore achevée.
Aujourd’hui, sur le continent, seule la banque mauricienne MCB a une notation suffisante pour être labellisée « investment grade » à une échelle globale et peut donc, par exemple, confirmer des lettres de crédits lors des transactions commerciales internationales. La croissance de la Côte d’Ivoire et du Sénégal tient beaucoup aux secteurs minier et pétrolier. Des marchés très capitalistiques qui restent encore l’apanage des banques internationales, les américaines en tête.
Pour briser ce plafond de verre, la réglementation doit suivre. Depuis l’an dernier, le capital social des banques est passé de 10 à 20 milliards de F CFA (de 17 à 34 millions de dollars). D’autres mesures sont attendues, comme un renforcement de la compliance (protection des données, cybersécurité, gestion des risques opérationnels, etc.) et des obligations émises par le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba): « L’architecture de la finance africaine n’est pas encore achevée, concède Jean Didier Attingli. Sur le moyen terme, ces mesures rendront plus crédible et attractive l’économie africaine. C’est de cette crédibilité que naîtra la solidité de nos industries. L’augmentation du capital qui s’est imposée à certaines banques à ses effets. »
À ces contraintes devraient s’adjoindre des facilités financières. Les problèmes de change entre les monnaies continentales limitent l’intégration, bien que le besoin s’en fasse déjà sentir. Pour financer leurs activités, les États de l’Afrique de l’Ouest recherchent l’expérience des grands groupes anglophones, « qui ont vu déjà sur le court et moyen terme de bonnes raisons pour s’installer dans notre espace », précise l’analyste togolais. Les banquiers sont donc les premiers supporters de l’intégration, car ils en seront les premiers bénéficiaires. Jusqu’à un certain point. Car les analystes s’attendent à ce que vienne, après l’éclosion et la consolidation, la période de la rationalisation, où seuls les plus forts survivront. On verra alors les groupes panafricains se battre, non pas pour récupérer les restes des banques étrangères ou pour se positionner sur de nouveaux marchés, mais pour racheter les filiales des banques qui n’auront pas pu suivre la course à la modernisation. Pour elles, plus dure sera la chute.
Source: JeuneAfrique
Pour plus d’informations et d’analyses sur la CentrAfricaine, suivez Africa-Press