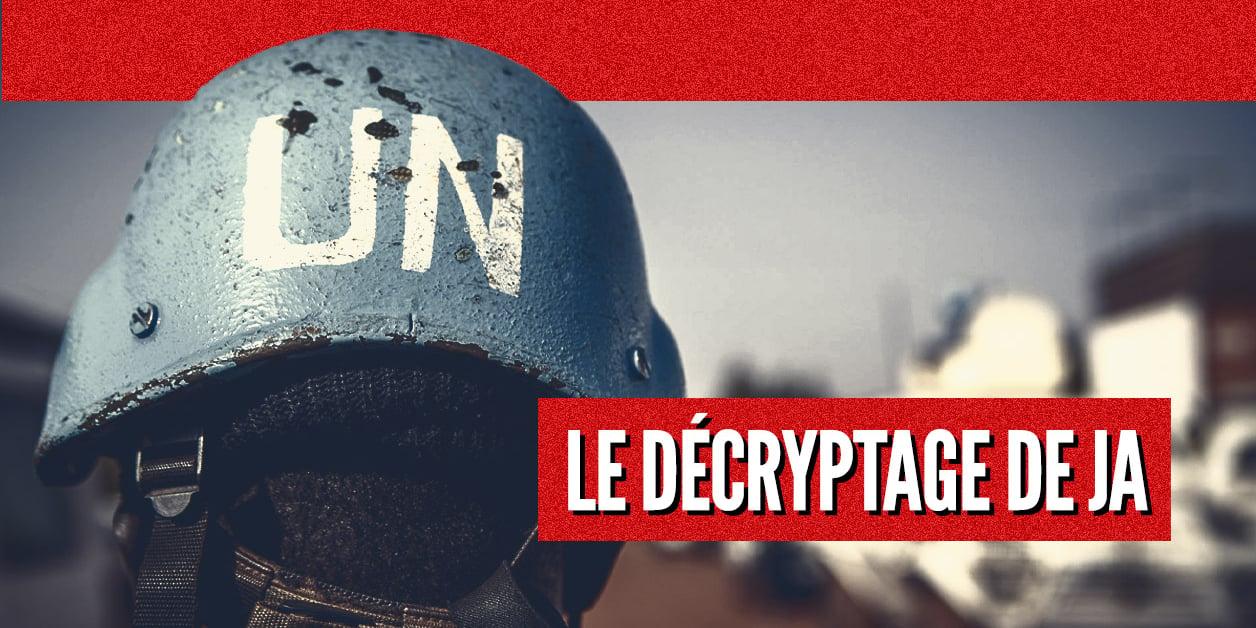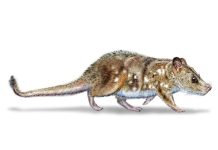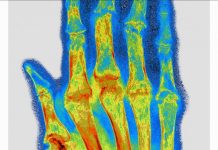Africa-Press – Côte d’Ivoire. Le décryptage de JA – C’est du jamais-vu. Alors même que les deux pays sont en état de paix, le 10 juillet dernier, 49 militaires ivoiriens venus opérer au sein de la force de maintien de la paix au Mali (Minusma) ont été arrêtés à Bamako. Un mois et demi plus tard, trois d’entre eux – les trois femmes du bataillon – ont été relâchés. Et depuis, plus rien.
Bamako continue d’accuser ces militaires d’être des mercenaires envoyés pour déstabiliser la junte au pouvoir, ce que la Côte d’Ivoire nie fermement. Celle-ci a expliqué que ces forces sont le 8e détachement du National Support Element (NSE), chargé d’appuyer le contingent allemand de la Minusma et de sécuriser certains sites logistiques. Abidjan dénonce le « chantage » dont elle est victime de la part du Mali. António Guterres, le secrétaire général des Nations unies, a confirmé que ces soldats « ne sont pas des mercenaires » et a demandé leur libération.
Pour tenter de faire décroître les tensions, plusieurs médiations ont été lancées, dont celle menée par le Togo, mais sans qu’aucune ne soit concluante. Jeune Afrique fait le point sur cette crise qui s’éternise.
1. Où sont les militaires ivoiriens ?
Depuis leur arrestation le 10 juillet à l’aéroport international Modibo-Keïta, les militaires ivoiriens ont été conduits à l’école de gendarmerie de Bamako. Selon nos informations, ils seraient physiquement bien traités, même si certaines sources soulignent qu’ils sont victimes de pressions psychologiques et qu’ils n’ont pas pu communiquer avec leurs proches. À part leurs geôliers, peu de personnes ont accès à eux.
Le 3 août dernier, le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et le chef d’état-major des armées, le général Lassina Doumbia, avaient reçu les familles de ces soldats afin de les rassurer. Ils leur avaient certifié l’implication du président Alassane Ouattara dans le dossier et annoncé le versement d’une somme de 300 000 francs CFA (456 euros) à chaque famille.
Alors qu’à Abidjan beaucoup redoutaient une judiciarisation de l’affaire, les craintes se sont concrétisées. Le procureur général près la cour d’appel de Bamako a inculpé les soldats ivoiriens pour « tentative d’atteinte à la sûreté de l’État » le 19 juillet, compliquant encore un peu plus leur libération.
2. Pourquoi n’ont-ils toujours pas été libérés ?
Les négociations ont tour à tour été interrompues et relancées durant ces quatre derniers mois, mais, début octobre, l’optimisme était de rigueur à Abidjan. Il semblait ne rester qu’un seul point de blocage, celui portant sur le lieu de libération des militaires, Bamako ou Lomé – au Togo – étant envisagés.
Le 6 octobre, cette question avait été évoquée entre Alassane Ouattara et son homologue togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, médiateur dans cette crise. Une semaine plus tôt, le 29 septembre, une mission de haut niveau de la Cedeao, composée des présidents ghanéen Nana Akufo-Addo et gambien Adama Barrow, ainsi que du chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, s’était rendue à Bamako et avait été reçue par Assimi Goïta. Si rien n’avait officiellement filtré de cet entretien, en coulisses, les différentes parties ne cachaient pas leur optimisme quant à un dénouement imminent.
Pourtant, aucun accord n’a été trouvé, figeant une fois de plus les discussions. Celles-ci ne sont néanmoins pas interrompues : Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires étrangères, a effectué un discret séjour à Bamako début novembre.
3. Les soldats ivoiriens permettent-ils à Bamako d’exercer un chantage sur Abidjan ?
Alors que les autorités maliennes qualifient les militaires ivoiriens de « mercenaires », la Côte d’Ivoire estime qu’ils sont « otages » d’un chantage qu’exerce le Mali.
Tour à tour, Bamako a en effet formulé plusieurs exigences en échange de la libération des soldats. Assimi Goïta a demandé l’extradition de personnalités maliennes vivant en Côte d’Ivoire comme contrepartie. Il s’agit entre autres de l’ancien ministre des Affaires étrangères Tiéman Hubert Coulibaly, de l’ancien député et fils de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), Karim Keïta, ou encore de l’ancien Premier ministre Boubou Cissé, en exil entre Niamey et Abidjan depuis plus d’un an. Ces personnalités font l’objet de mandats d’arrêts internationaux émis par Bamako.
Les autorités maliennes souhaitent remplacer Moustapha Ben Barka, ancien secrétaire général et neveu d’IBK, à la tête de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD).
Le président de la transition malienne a également demandé l’intervention de Ouattara pour mettre un terme à ce qu’il considère comme des « tracasseries » de la part de la BCEAO.
En plus de ces exigences, le Mali a soumis fin octobre à la Côte d’Ivoire un projet d’accord dans lequel Abidjan s’engagerait à un « pacte de non agression ». Celui-ci exigerait que les Ivoiriens reconnaissent avoir tenté de « déstabiliser » leur voisin. S’il a refusé de se plier à ces demandes, le président ivoirien a aussi tenu à ne jamais abandonner le dialogue. Il a ainsi décidé de ne pas user de mesures de rétorsion, comme de couper l’alimentation en électricité du Mali.
4. Qui gère le dossier ?
À la demande des Maliens, proches du président Faure Essozimna Gnassingbé, une médiation togolaise s’est saisie du dossier dès le 29 juillet. C’est le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, qui est à la manœuvre pour les négociations. Côté malien, c’est le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui s’exprime au nom de son pays. Alassane Ouattara a pour sa part mandaté son directeur de cabinet et secrétaire du Conseil national de sécurité (CNS), Fidèle Sarassoro, et son ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara.
En plus de la médiation togolaise, des discussions parallèles ont eu lieu depuis l’arrestation des soldats : entretiens entre chefs d’état-major ; contacts entre le coordonnateur national du renseignement ivoirien et le directeur général de la sécurité d’État du Mali ; échanges entre Téné Birahima Ouattara et le directeur de cabinet du colonel Assimi Goïta, ainsi qu’avec Sadio Camara, le ministre de la Défense malien.
Plusieurs chefs d’État de la sous-région se sont également impliqués pour tenter de trouver une issue à la crise. Le Sénégalais Macky Sall, président en exercice de l’Union Africaine, le Bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló, président en exercice de la Cedeao ou encore le Nigerian Muhammadu Buhari. L’ONU a également tenté une médiation. Le 9 août, à la demande d’António Guterres, Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations unies, et Mahamat Saleh Annadif, envoyé spécial de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest, se sont rendus à Abidjan, avant de s’envoler le lendemain pour Bamako.
Enfin, des canaux moins diplomatiques ont été activés. Dès le 20 août, une délégation de religieux et d’hommes d’affaires ivoiriens s’est rendue à Bamako. Elle a été reçue par les ministres Abdoulaye Diop et Abdoulaye Maïga (Administration territoriale et Décentralisation), nommé Premier ministre intérimaire.
Ally Coulibaly, conseiller du président ivoirien, accompagné d’une délégation, a également rencontré l’influent chérif de Nioro.
5. Des opposants ivoiriens impliqués ?
Abidjan souhaite que la plus grande discrétion soit observée sur ce dossier et que les interférences soient limitées, afin que la crise prenne fin. Ainsi, les autorités ont peu apprécié le séjour au Mali de la militante proche de l’opposition Pulchérie Gbalet. Celle-ci a dit avoir rencontré des organisations de la société civile et des autorités maliennes afin de « mieux comprendre » les raisons de l’arrestation de ses compatriotes, mais a été arrêtée de retour en Côte d’Ivoire.
Elle a été inculpée « d’entente avec les agents d’une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d’Ivoire, de manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions et à occasionner des troubles graves à l’ordre public ». Dans un communiqué rendu public le 26 août, le procureur de la République Richard Adou explique qu’elle s’est lancée « dans une véritable campagne de dénigrement de l’action du président de la République et du gouvernement dans la gestion de la crise liée à la rétention de 49 de nos soldats au Mali ».
À Abidjan, on soupçonne également l’ancien président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro de perturber les négociations. « L’activisme des avatars proches de Soro sur les réseaux sociaux dès les premières heures de leur arrestation – ils ont été les premiers à donner l’information de cette interpellation – nous a paru suspect », confie un officiel sous couvert de l’anonymat.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press