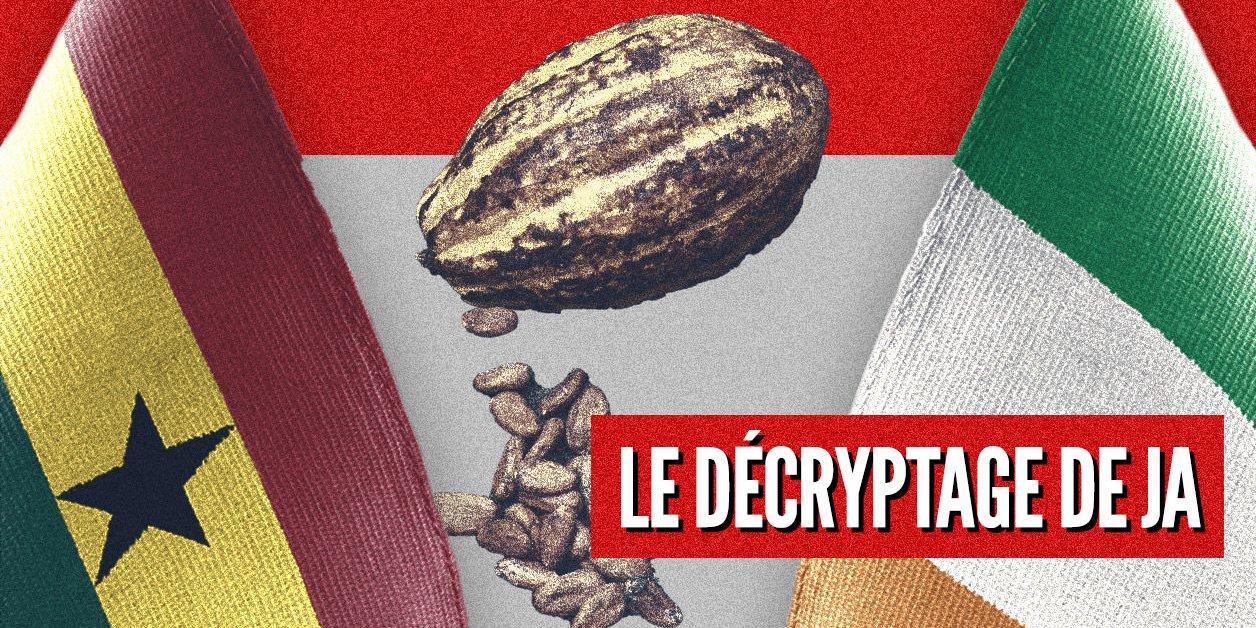Africa-Press – Côte d’Ivoire. LE DECRYPTAGE DE JA – Les deux pays ouest-africains ont noué une alliance dans le but de faire pièce aux acteurs internationaux du secteur du cacao. Pourquoi ce partenariat était-il nécessaire ? Est-il véritablement efficace ? Comment l’axe Abidjan-Accra se positionne-t-il sur le plan international ? Quelles sont les retombées pour les planteurs ? Jeune Afrique fait le point des enjeux et défis qui se posent dans ce secteur stratégique.
1. Pourquoi la Côte d’Ivoire et le Ghana ont-ils noué une alliance ?
Réhabiliter la place des cacaoculteurs en augmentant leur rémunération. C’est l’objectif principal de l’alliance, surnommée « Opep du cacao », nouée en 2018 par la Côte d’Ivoire et le Ghana. Ces deux pays, premier et deuxième producteur mondial de fèves (avec respectivement 2,2 millions et 1 million de tonnes produites lors de la campagne 2020-2021), assurent près de 70 % de l’approvisionnement de cacao au niveau international. Forts de cette position, ils veulent corriger un écueil historique qui fait des planteurs le maillon le plus faible – alors qu’il est indispensable – de la chaîne cacaoyère.
Les pays producteurs ne touchent que 6 % des recettes d’un marché de 130 milliards de dollars
« On estime que 40 % des revenus de la filière reviennent à la grande distribution et autant aux chocolatiers, quand les traders et intermédiaires récoltent autour de 10 %. Les pays producteurs ne touchent, eux, que 5 % à 6 % des recettes d’un marché qui représente 130 milliards de dollars par an », expose Alex Assanvo, le secrétaire exécutif de l’Initiative Côte d’Ivoire Ghana, plateforme coordonnant l’action des deux États et de leurs régulateurs respectifs, le Conseil du Café-Cacao (CCC) ivoirien et le Cocoa Board (Cocobod) ghanéen.
Pour remédier au problème, Abidjan et Accra ont pris une décision forte en juillet 2019 : instaurer un « différentiel de revenu décent » (DRD), une prime de 400 dollars la tonne, venant s’ajouter au prix d’achat des fèves, formé par l’addition du cours fixé sur les marchés mondiaux à terme et d’une prime pays liée à qualité. Fraîchement accueillie par les acheteurs, la mesure est tout de même entrée en vigueur à compter de la campagne 2020-2021 avec l’objectif de maintenir un prix plancher du cacao à 2 600 dollars la tonne.
2. Quels sont les résultats de ce partenariat ?
Alors que la campagne de commercialisation 2022-2023 des fèves s’est ouverte le 1er octobre, l’heure est au bilan, positif à deux principaux égards. D’une part, alors que ce n’était pas gagné d’avance, l’alliance entre Abidjan et Accra tient bon, se renforçant même au fil du temps : depuis mai, les deux pays publient chaque mois le montant de leur prime qualité respective, un effort de transparence conjoint qui accroît la pression sur les acheteurs. De même, malgré les réticences contre le DRD, ce dernier est devenu de fait un instrument permettant d’influer sur le marché mondial.
IL DEMEURE BEAUCOUP DE TENSIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS
D’autre part, l’action ivoiro-ghanéenne renforce toutes les initiatives en faveur de la durabilité lancée ces dernières années – que ce soit par les organismes de certification, les coopératives, les acheteurs de fèves et les multinationales ou encore l’Union européenne –, les eurodéputés ayant adopté à la mi-septembre une législation contre la déforestation importée (interdisant l’importation de produits ayant contribué à la destruction d’écosystèmes comme les forêts dans le cas du cacao). Résultat, le patron du CCC, l’Ivoirien Yves Brahima Koné, a annoncé « la mise en place du système de traçabilité de tout le cacao, depuis le champ jusqu’à l’usine des exportateurs » pour la campagne 2023-2024. Début octobre, l’exécutif ivoirien a fixé le prix d’achat du cacao pour la campagne 2022-2023 à 900 F CFA le kilo (1,37 euro), en hausse de 9 % par rapport à la campagne précédente (le Ghana lui a emboîté le pas en fixant un prix en hausse de 21 % sur un an à 12,8 cédis le kilo, soit environ 806 F CFA), tout en annonçant avoir distribué 350 000 cartes de planteurs, 250 000 autres devant suivre, une façon de progresser sur la transparence de la filière.
« Si tout le monde a embarqué dans le processus, il demeure beaucoup de tensions entre les différents acteurs, notamment sur le choix de l’entité qui doit le contrôler », confie un bon connaisseur du secteur. Les organismes de certification, longtemps à la pointe sur le sujet, ont vu leur influence se réduire, tantôt accusés de disposer de trop de pouvoir, tantôt critiqués pour certains manquements à la traçabilité promise. Les chocolatiers, consentant à payer plus cher les fèves, entendent en échange édicter les règles imposées à l’or brun. Ces deux velléités entrent en conflit avec la volonté des pays producteurs de reprendre la main sur leurs ressources pour mieux valoriser le travail de leurs planteurs. Cela explique que, si la filière a fait des progrès sur le plan de la traçabilité des fèves, les avancées sur le volet de la rémunération sont encore ténues.
3. Est-il possible d’obtenir une bonne rémunération pour les planteurs ?
À cette question, tous les acteurs répondent de façon affirmative. « Circuits courts, certifications bio, hausse de la qualité des fèves, DRD… Il y a beaucoup de mécanismes qui permettent en principe aux cacaoculteurs de toucher une rémunération supérieure à la moyenne du secteur », exposent Martijn ten Hoopen et Stéphane Saj, spécialistes du cacao au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad). Une étude scientifique publiée en 2015 a ainsi chiffré à 6 % le gain de revenus généré par le cacao durable et équitable par rapport à une production conventionnelle en Côte d’Ivoire.
Dans la pratique, toutefois, les progrès ne concernent qu’une quantité limitée de fèves et donc qu’un nombre réduit de producteurs, la majorité d’entre eux ne voyant pas leurs revenus augmenter significativement. Outre les difficultés liées à la mise en œuvre des mécanismes, plusieurs autres facteurs jouent défavorablement. Ainsi de la tendance baissière des cours mondiaux du cacao depuis 1950 (malgré un pic de prix dans les années 1970) avec une tonne autour des 2 000 dollars actuellement et, depuis le début de l’année, la flambée du prix des intrants et engrais, synonyme de hausse de coûts de production et de moindre recettes.
PERSONNE NE VEUT ACHETER AU PRIX SOUHAITÉ PAR LES DEUX PAYS
« Les efforts déployés ne résolvent pas l’asymétrie de fond qui existe sur le marché entre un petit nombre d’acheteurs en situation de quasi-oligopole et des vendeurs qui doivent écouler une marchandise ne pouvant être stockée facilement », reprennent les chercheurs Martijn ten Hoopen et Stéphane Saj. Cette situation explique pourquoi il est si compliqué pour le tandem ivoiro-ghanéen de gagner le bras de fer engagé. « Personne ne veut acheter au prix souhaité par les deux pays, et cela d’autant moins qu’il y a une incertitude sur le niveau de la demande en cacao ces prochains mois en raison des craintes sur l’approvisionnement en énergie des industries, y compris alimentaires », commente le connaisseur du secteur sollicité.
Une annonce récente illustre toute la difficulté de la situation. Mi-septembre, en marge d’échanges organisés par l’Association européenne pour le cacao (ECA) à Rome, Cargill et le CCC se sont félicités de la vente d’une cargaison de 25 000 tonnes de cacao à un prix incluant l’ensemble des primes, y compris une prime pays non négative. Explications : depuis l’entrée en vigueur du DRD, la prime pays n’a, elle, cessé de diminuer jusqu’à devenir négative, effaçant les gains attendus pour les producteurs. Ce contournement du DRD, déploré par Abidjan et Accra, a conduit les deux pays à rendre publique la prime pays pour contrer la manœuvre des acheteurs… Dans ce cadre, la vente des 25 000 tonnes, un volume très modeste à l’échelle de la filière ivoirienne, doit être lue comme une tentative de créer un effet d’entraînement sur le reste des acheteurs – en vain jusqu’à présent.
4. Pourquoi la traçabilité des fèves compte-t-elle ?
Le bras de fer mené sur la rémunération s’inscrit dans un contexte de réforme de l’ensemble de la filière afin de la rendre plus durable, via des investissements dans la traçabilité des fèves, la lutte contre la déforestation, la formation des agriculteurs et l’élimination du travail des enfants. Ce mouvement s’est engagé au niveau mondial en réponse à une demande croissante des consommateurs pour un chocolat plus équitable et respectueux de l’environnement. Un chocolat qui, par ricochet, est vendu plus cher.
Dans ce cadre, la traçabilité des fèves est présentée comme le moyen de renforcer la transparence de la filière. Il s’agit d’assurer aux chocolatiers et consommateurs qu’ils achètent bien un produit conforme à leurs exigences et à l’Union européenne que sa contribution annoncée de 1 milliard d’euros sert effectivement à moderniser et à rendre plus « verte » la filière. Pouvoir retracer l’origine de la fève permet d’en garantir la qualité mais aussi d’éliminer les zones grises, notamment les nombreux intermédiaires « bord de champs », tout en consolidant les coopératives et leurs producteurs associés.
LES ACHETEURS ONT RÉPONDU AUX EXIGENCES IVOIRO-GHANÉENNES EN DIVERSIFIANT LEUR SOURCE D’APPROVISIONNEMENT
La traçabilité physique doit, in fine, ouvrir la voie à la traçabilité financière, insiste l’« Opep du cacao »: une fois recensés et identifiés, les planteurs, dont la production est tracée, peuvent recevoir directement – notamment via mobile money – le paiement du travail effectué. Si Cargill, Barry Callebaut, Olam, Touton, Cémoi mais aussi Mars, Hershey, Mondelez, Nestlé mettent l’accent sur les progrès réalisés en matière de traçabilité et sur les gains pour les producteurs, tous les acteurs ne lient pas aussi fortement traçabilité et rémunération. Le duo ivoiro-ghanéen déplore ainsi que la législation européenne contre la déforestation importée ne mentionne pas le DRD, insistant pourtant sur le fait que la durabilité souhaitée ne peut fonctionner que si elle repose sur trois piliers, social, environnemental et économique…
5. L’Amérique latine menace-t-elle les efforts africains ?
Le pari de la Côte d’Ivoire et du Ghana se complique encore lorsque l’on rappelle que si ces pays sont les deux principaux producteurs de fèves du monde, ils n’en sont pas les seuls. Résultat, les acheteurs ont répondu aux exigences ivoiro-ghanéennes en diversifiant leur source d’approvisionnement ailleurs en Afrique et en Amérique latine. Ils se tournent ainsi vers le Cameroun et le Nigeria (quatrième et cinquième producteurs mondiaux selon les données de l’Organisation internationale du cacao, ICCO) mais aussi vers l’Équateur (troisième producteur mondial selon l’ICCO), le Brésil, le Pérou, la Colombie et la Bolivie.
Certes, aucun de ces pays n’est capable de rivaliser avec Abidjan et Accra en termes de volume, le Cameroun visant les 300 000 tonnes annuelles pour 2022-2023, et l’Équateur occupant la troisième place mondiale avec 375 000 tonnes, bien loin des chiffres de la Côte d’Ivoire et du Ghana. De même, la qualité des fèves varie d’un pays à un autre, celle des productions camerounaises et nigérianes, par exemple, ne parvenant pas à rivaliser avec les résultats ivoiriens et ghanéens.
DES DISCUSSIONS AVEC LE CAMEROUN ET LE NIGERIA POUR LEUR ENTRÉE DANS L’ALLIANCE SONT ENGAGÉES, SANS RÉSULTAT POUR L’HEURE
Cela dit, la concurrence des autres producteurs, en affaiblissant le rapport de force instauré par l’«Opep du cacao », constitue un problème pour Abidjan et Accra. C’est pour cette raison que des discussions sont engagées avec le Cameroun et le Nigeria – dont les productions ont respectivement augmenté de 17 % et 14 % entre 2016-2017 et 2021-2022 – en vue de leur entrée dans l’alliance, sans avancée concrète pour l’heure.
Outre-Atlantique, les deux compétiteurs sérieux sont l’Équateur et le Brésil, leur production annuelle ayant bondi de 29 % et 26 % entre les campagnes 2016-2017 et 2021-2022. À court terme, l’impact négatif pour l’« Opep du cacao » demeure limité : il faudra du temps avant d’atteindre des niveaux importants de production, le Brésil est handicapé par l’existence de maladies touchant les cacaoyers, et la production sud-américaine se destine en premier lieu au marché nord-américain. Pour autant, à moyen et long terme, alors que la Côte d’Ivoire et le Ghana devront d’ici à vingt ans renouveler leur plantation pour maintenir leur domination mondiale, l’Amérique latine affiche un plus grand potentiel d’augmentation des surfaces agricoles.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press