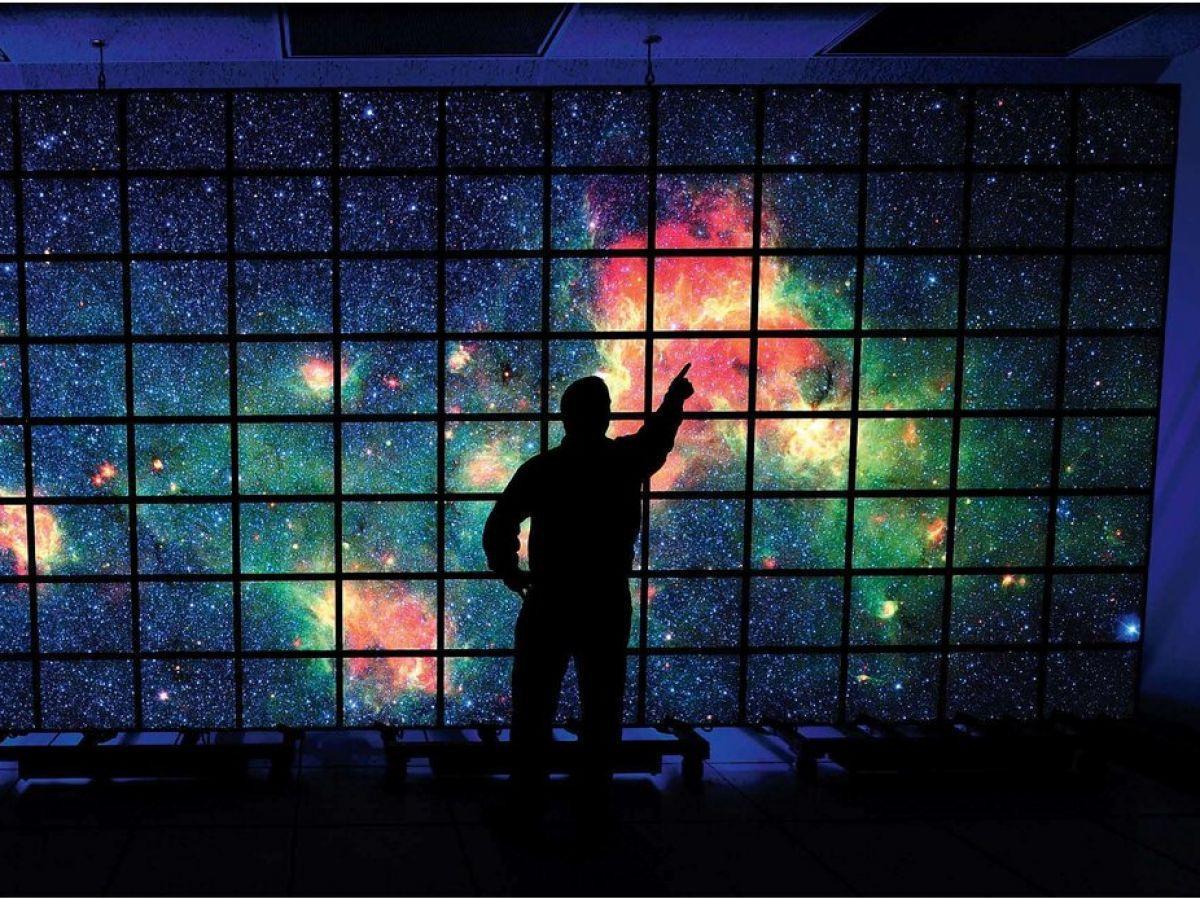Africa-Press – Côte d’Ivoire. Étudier le ciel étoilé peut sembler une activité bien peu polluante. Pourtant, avec en moyenne 56 tonnes d’équivalent CO2 (teqCO2) par an et par astronome en France, l’astronomie fait partie des domaines de recherche les plus émetteurs de gaz à effet de serre, selon le rapport de synthèse de la prospective astronomie-astrophysique 2025-2030 de l’Institut national des sciences de l’Univers (Insu). Rappelons qu’un Français émet, en moyenne, 10 teqCO2 par an et que, selon les objectifs de la loi européenne sur le climat, pour atteindre une neutralité carbone, les émissions devront se limiter à 2 tonnes par an et par personne en 2050. Un astronome, c’est près de 30 fois plus !
Face à ce constat, certains chercheurs s’interrogent. Héloïse Méheut, astrophysicienne au CNRS sur le site de l’observatoire de la Côte-d’Azur et spécialiste de la formation des planètes, a réorienté sa recherche en limitant l’usage des supercalculateurs. Ceux-ci servent à recréer des formations planétaires, l’intérieur d’une étoile ou des interactions entre galaxies. Si elle ne peut s’en passer, elle fait appel à ceux situés dans des pays dont l’électricité a une faible empreinte carbone.
« Pourquoi ne pas réduire le nombre de grandes simulations cosmologiques, en renforçant la coopération », suggère de son côté l’astronome Leonard Burtscher, cofondateur d’Astronomers for Planet Earth, un collectif créé en 2019 qui informe et agit en faveur de la transition climatique.
Mais ce sont avant tout les observatoires, télescopes et autres sondes qui constituent la source majeure d’émissions de gaz à effet de serre, avec 39,7 teqCO2 par an et par astronome, selon une étude de chercheurs de l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (Irap) publiée en 2024 dans Nature Astronomy. L’Observatoire européen austral (ESO), la première organisation astronomique intergouvernementale européenne, s’est attelé à la décarbonation de son fonctionnement dès 2018.
« Des centrales solaires photovoltaïques ont été installées à La Silla et à Paranal (Chili), couvrant la totalité des besoins en électricité le jour. Le réseau électrique chilien est devenu moins émetteur. Et nous avons fait de grands efforts d’électrification de la flotte de véhicules et des systèmes de chauffage », détaille son responsable du développement durable Claudio Melo. Ainsi, l’ESO a divisé par deux ses émissions de CO2 liées à l’énergie, qui représentaient 41 % de son empreinte carbone totale de 28.000 teqCO2 en 2018.
Mais une grande partie des émissions a lieu lors de la construction des instruments. « Produire du béton et de l’acier sans libérer du CO2 est difficile », rappelle Leonard Burtscher. Une solution pour les futures infrastructures « consisterait à arrêter la croissance du nombre d’infrastructures en activité en le maintenant aux niveaux actuels. […] Celles existantes seront remplacées à la fin de leur durée de vie par d’autres de masse ou de coût équivalents », selon l’étude publiée en 2024 dans Nature Astronomy.
Mais le sujet est sensible, prévient Alexandre Santerne, astronome adjoint au Laboratoire d’astrophysique de Marseille (LAM) et membre du groupe de travail sur la transition carbone pour la prospective astronomie-astrophysique 2025-2030 de l’Insu: « La plupart des chercheurs sont d’accord sur le principe, du moment que cela ne concerne pas leur instrument. Abandonner un instrument signifie devoir trouver un autre sujet de recherche. » Un tel scénario aurait néanmoins des bénéfices. Astronome adjoint à l’Irap, Frédéric Boone estime ainsi qu’il permettrait de « sortir de la course aux publications », cette urgence de devoir publier vite des résultats.
Limiter le nombre d’infrastructures en activité permettrait aussi de « maximiser le retour scientifique » de chacune d’entre elles, fait valoir Mickaël Coriat, astrophysicien à l’Irap qui s’est désengagé du projet du radiotélescope Square Kilometre Array (SKA) alors qu’il avait fait son post-doctorat en Afrique du Sud, l’un des sites de déploiement avec l’Australie. « Ce n’était plus viable pour moi de participer à ce type de projets. J’essaie de faire de la science avec l’existant, avec des données sous-exploitées par exemple », confie-t-il.
Exploiter davantage les données d’archives
Aux États-Unis, les coupes budgétaires des activités de la Nasa et de la Fondation nationale pour la science voulues par Donald Trump – respectivement annoncées à 6 et 5 milliards de dollars – pourraient accélérer ce mouvement, car elles conduiraient « à une plus forte dépendance à l’égard des données d’archives », prédit Travis Rector, astrophysicien à l’université d’Alaska Anchorage (États-Unis), en précisant aussi qu’elles impliqueront une réduction du personnel en astronomie.
Par ailleurs, avec les nouveaux observatoires comme Vera-Rubin, capable de détecter 10 millions d’événements transitoires par nuit, « on n’a pas assez de chercheurs pour analyser le flux de données collectées. A priori, on pourrait faire baisser le nombre d’instruments. Mais on va surtout utiliser l’intelligence artificielle pour gérer le flux de données et les chercheurs vont de moins en moins regarder les données eux-mêmes », avance Jürgen Knödlseder, astrophysicien à l’Irap et auteur principal de l’étude sur les infrastructures.
Reste enfin la question des déplacements des astronomes. Selon une étude publiée en 2022 dans Plos Climate, ils font partie des scientifiques qui prennent le plus l’avion. À l’ESO, les déplacements professionnels représentaient 10 % de l’empreinte carbone en 2018. Or, une partie des télescopes peuvent être pilotés à distance: l’astronome a un temps d’observation programmé à une heure précise et utilise le télescope à distance via Internet. Mieux, de nombreux petits télescopes fonctionnent aujourd’hui en mode « robot », de façon presque automatisée: « Sur la base d’un algorithme, un ordinateur décide des observations à effectuer et les exécute », résume Travis Rector.
Autre solution déployée à l’observatoire Gemini: des astronomes sur site font les observations demandées par leurs collègues du monde entier en fonction de l’ordre de priorité, des conditions météorologiques, de la qualité de l’image et de la phase de la Lune. « La technologie a permis de réduire les émissions tout en étant plus productif sur le plan scientifique », assure l’astrophysicien.
Des réunions virtuelles plutôt que des déplacements en avion
Les astronomes prennent aussi souvent l’avion pour participer aux congrès. Les conférences d’astronomie et d’astrophysique en présentiel étaient à l’origine de 42.500 teqCO2 en 2019, soit une moyenne de 1 teqCO2 par participant et par conférence, selon une étude publiée en 2024 dans Pnas Nexus. « L’empreinte carbone d’une réunion virtuelle est d’un millième de celle d’une réunion en présentiel, elle est plus accessible pour tous, sans oublier le gain de temps et d’argent », pointe Vanessa Moss, responsable des opérations scientifiques au radiotélescope Askap du CSIRO (Australie) et cheffe de file du mouvement The Future of Meetings (TFOM).
Mais la transition vers la visioconférence n’a rien d’une évidence: participer aux congrès est un passage obligé afin « de faire connaître ses recherches, que d’autres les citent et puissent vous offrir un poste un jour « , souligne Leonard Burtscher, qui a plus de quinze ans de carrière. Travis Rector juge toutefois que « le système doit changer, car il tend à récompenser ceux qui voyagent le plus, ceux qui ont la capacité et les ressources pour prendre l’avion et faire des programmes d’observation, présentations ou panels d’experts. » En France, l’Insu a amorcé ce changement en proposant de « reconnaître dans le suivi de carrière et le recrutement les activités visant à contribuer à la réduction de l’impact environnemental » de la recherche.
Mais pour réussir, le changement ne peut être que global. « Si nous durcissons notre politique alors que d’autres ne le font pas, nos scientifiques risquent d’être désavantagés, redoute Claudio Melo. Tout le monde hésite, ne voulant pas être seul. Le risque est que rien ne change. » Et il est réel.
Une préoccupation pour toutes les sciences
« La préoccupation de décarboniser la recherche n’est plus une question marginale », affirme Antoine Hardy, sociologue au Centre de sociologie de l’innovation et auteur d’une thèse sur la décarbonation de la recherche publique en France. En revanche, « la façon dont on voit la décarbonation diffère selon les disciplines », ajoute-t-il.
Dans certaines comme la géologie, ne plus prendre la voiture pour se déplacer remet en cause le fait même de faire de la recherche, alors que dans d’autres, il est possible d’en réduire l’usage sans affecter les activités des chercheurs. Le collectif Labos 1point5 a développé un outil gratuit pour calculer l’empreinte carbone et établir le bilan gaz à effet de serre réglementaire d’un laboratoire. À ce jour, plus de 1600 laboratoires l’ont fait et 79 ont publié près de 300 actions menées pour la réduction durable de leur empreinte environnementale.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press