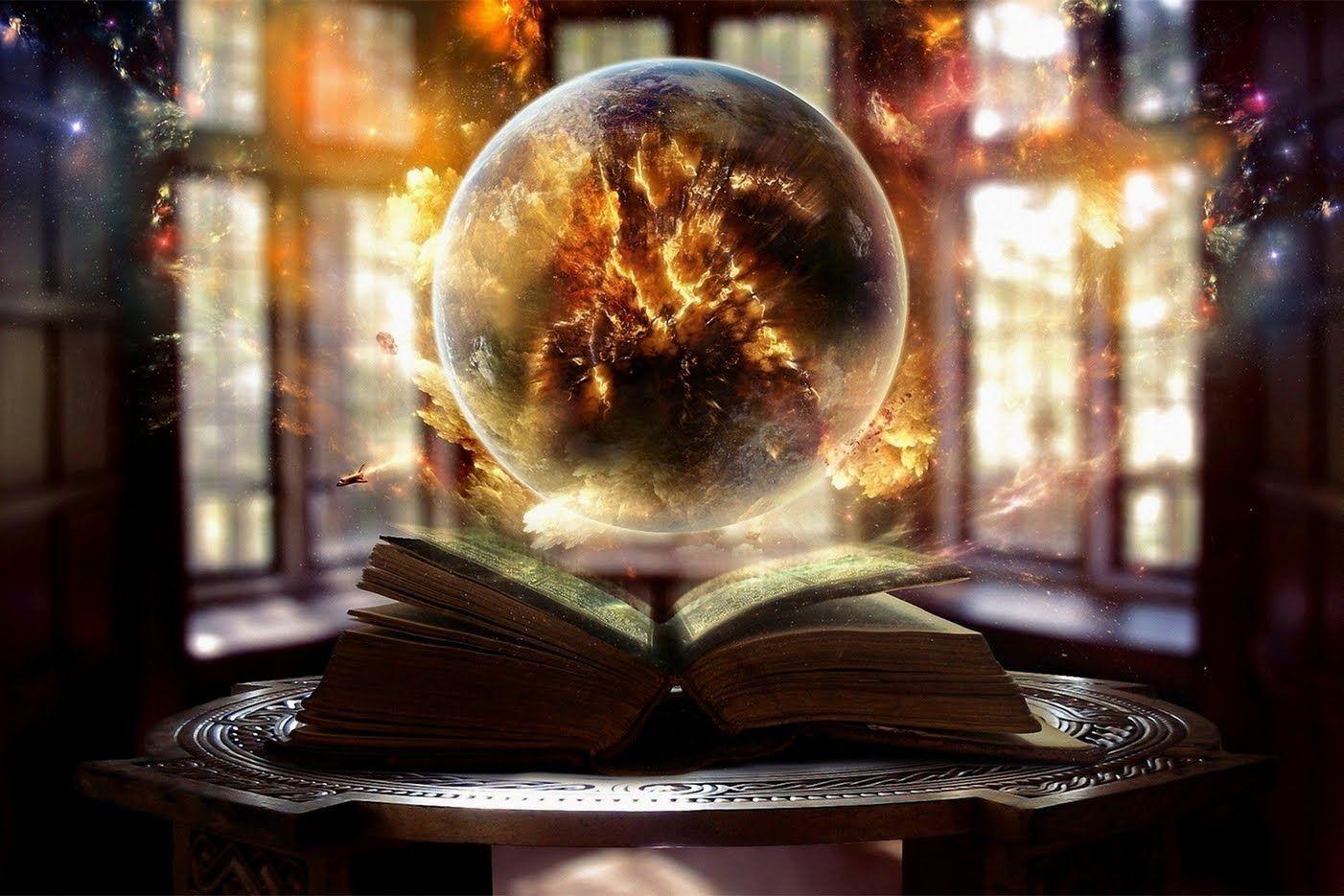Anouar CHENNOUFI
Africa-Press – Mali. La décision de la France de retirer ses forces militaires du Mali révèle une nouvelle dynamique dans la région du Sahel, qui s’explique par deux types de raisons :
• des raisons structurelles
Comme l’incapacité de l’État à assurer ses fonctions traditionnelles de garantir la sécurité pour tous et d’assurer les besoins de ses citoyens,
• des raisons politiques
Notamment la transformation de la région en un foyer du terrorisme mondial et local (Al-Qaïda, Daech, organisations locales à caractère ethnique), une situation qui a attiré davantage d’interventions étrangères, qu’elles soient traditionnelles comme représentées par la France et l’Occident, ou émergentes représentées par la Russie et la Chine.
Ce sont des dynamiques qui semblent être à l’origine des changements dans les rapports de force au Mali, et dans la région du Sahel dans son ensemble, car elles poussent les élites locales, qu’elles soient militaires ou civiles, à reconsidérer leurs calculs antérieurs, y compris leurs alliances traditionnelles avec la France, en particulier avec la disponibilité d’autres alternatives, telles que la Russie et la Chine.
Cette même dynamique a été exploitée par la France pour repositionner la stratégie, en réorganisant soigneusement ses priorités, compte tenu des capacités économiques limitées de sa présence partout, et du rôle militaire et économique grandissant de la Russie et de la Chine, sans parler de l’état croissant de l’hostilité intérieure contre la présence militaire de la France en tant que puissance coloniale.
Des considérations qui sont sans aucun doute à l’origine de la redéfinition de ce qu’ils considèrent comme des intérêts vitaux dans la région, et de ce qu’ils ne considèrent pas comme tels et peuvent être abandonnés à d’autres, dont la Russie et la Chine, ce qui les fait apparaître comme interagissant positivement avec les courants locaux qui les rejettent, alors qu’il s’agit d’une nouvelle stratégie pour fortifier son influence traditionnelle.
Au vu de ce qui précède, nous essayons d’analyser le contexte de la décision française vis-à-vis des alternances de pouvoir au Mali et dans la région du Sahel, qui se caractérise par une forte instabilité alimentée par la fragilité des pays de la région et les menaces croissantes des forces non étatiques. Ceci suppose que les changements dans les rapports de force au Mali et dans la région du Sahel et la disponibilité d’alternatives militaires offertes par la Russie, ont poussé la France à faire de nouveaux calculs, qui lui ont dicté de faire réduire sa présence militaire directe, avec le repositionnement dans ses sphères d’influence les plus vitales, comme le Niger, tout en abandonnant ses zones moins importantes, comme le Mali.
De facto, la décision française de se retirer du Mali, annoncée le 17 février 2022, n’a donc rien de surprenant.
Cependant, la décision a eu un impact énorme dans le contexte d’une crise diplomatique sans précédent entre les deux pays. La France, l’ancienne puissance coloniale qui considère le Mali et le Sahel comme une arène d’influence géopolitique, a justifié la décision de se retirer par deux arguments :
• son refus de traiter avec une autorité militaire cherchant à se maintenir au pouvoir,
• son objection à la présence des mercenaires russes de Wagner.
Il faut dire que les deux arguments sont hautement suspects, car la France n’a rien de mal à soutenir des gouvernements similaires au Sahel arrivés au pouvoir de la même manière, par exemple au Tchad et au Burkina Faso.
Changements de pouvoir au Mali et au Sahel

La présence militaire française a commencé à se détériorer au Mali depuis les élections présidentielles d’août 2018, dont les résultats ont provoqué une profonde crise politique et entraîné des changements dans les rapports de force au sein du Mali, conjugués à des changements similaires dans la région du Sahel, qui s’est manifestée par l’émergence de nouvelles puissances internationales, telles que la Russie et la Chine, qui offrent des alternatives militaires et économiques et font couler la salive aux nouvelles élites de la région.
La France était consciente des erreurs qu’elle avait commises au Mali, et si elle avait reconnu le pouvoir de transition après le coup d’État d’août 2020, elle l’a fait après avoir nommé des civils du régime renversé à la tête de l’État et du Gouvernement réunis à la fois, à savoir : le Président de transition, Bah N’Daw, et le Chef du gouvernement de transition, Mokhtar Wan, dans les perspectives de travailler pour destituer les chefs militaires responsables du coup d’État susmentionné.
Ce qui s’est passé après le deuxième coup d’État, est l’aboutissement d’un changement profond dans les rapports de force au sein du Mali, qui a conduit à l’exclusion des élites traditionnelles au pouvoir – dont certaines alliées de la France – et à son remplacement par de nouvelles élites dans au moins deux postes, au sein de l’establishment militaire, où de jeunes officiers, sous la direction d’Assimi Goïta, occupaient les postes de décision militaire, et au sein des centres des institutions civiles, où les dirigeants de la « coalition du 5 juin » dominent la scène politique et civile, notamment l’imam Mahmoud Dicko.
A noter que, Mahmoud Dicko et le colonel Assimi Goïta entretenaient des relations solides, remontant à 2012, lorsque l’imam Dicko avait négocié avec des groupes armés du nord du Mali, qui avaient capturé des chefs militaires, dont Goïta lui-même, et les ont relâchés suite aux interventions de l’imam Dicko, symbole de l’islam modéré au Mali.
Cependant, le recul de la junte face aux pressions françaises et régionales a poussé le mouvement d’opposition du 5 juin à rejeter la feuille de route annoncée qui fixait la période de transition à 18 mois, menée par des personnalités civiles du régime déchu. Le mouvement a estimé que la feuille de route annoncée ne reflétait pas les aspirations du peuple malien qui avait manifesté pour renverser le président déchu Boubacar Keita et ses collaborateurs, soulignant que ce qui s’était passé impliquait une tentative des nouveaux militaires de monopoliser le pouvoir, et le mouvement a continué à faire pression sur le gouvernement de transition, ce qui a conduit à un deuxième coup d’État le 24 mai 2021, de la composante militaire dirigée par le colonel Assmi Goïta, contre la composante civile dirigée par le président de transition, Bah N’Daw, pour ouvrir la voie à une nouvelle alliance entre les militaires et les composantes du mouvement du 5 juin au sein de la nouvelle autorité, alliance que la France a rejetée.
Par ailleurs, l’audace de la nouvelle direction malienne face à la France est également indissociable des changements profonds dans les rapports de force qui s’opèrent au Sahel, car la présence croissante de puissances internationales telles que la Russie et la Chine a offert des options alternatives aux élites politiques et militaires des pays de la région.

Si l’on fait quelques pas en arrière, on découvre que dans les années 2015, 2016 et 2017, la Russie avait conclu des accords militaires avec le Mali, la République centrafricaine et le Niger, respectivement, et en juin 2021, elle a conclu un accord similaire avec la Mauritanie, dont le plus fort est de faciliter l’accès des pays de la région du Sahel au marché russe de l’armement, en plus de faciliter la conclusion d’accords avec le cabinet de conseil en sécurité Wagner, qui déploie ses forces en Centrafrique depuis juillet 2018, et elle semble exercer une forte tentation sur les autres États du Sahel, en tant qu’alternative disponible aux forces françaises dans la région.
Certes, la présence militaire française au Mali n’a pas atteint tous ses objectifs, néanmoins les erreurs commises par la France au Mali ont contribué à modifier les rapports de force à l’intérieur du pays, et cela semble jusqu’à présent dans l’intérêt des opposants à la présence militaire française, cependant, cela ne semble pas suffisant pour expliquer la décision de se retirer, avec ses répercussions sur l’influence française dans la région. Très probablement, il semble y avoir un nouveau calcul pour la France dans l’ensemble de la région du Sahel, qui s’explique principalement à la lumière de l’influence croissante de ses rivaux internationaux, tels que la Russie et la Chine.
Hors mis cela, il importe de reconnaître que la France a profité du coup d’État militaire au Mali pour reconsidérer sa stratégie militaire dans la région du Sahel, après avoir été convaincue que la solution militaire traditionnelle ne peut pas résoudre les guerres contre des groupes armés opérant avec une logique différente, et exploitant à leur tour l’état d’hostilité populaire pour l’ancienne puissance coloniale.
D’ailleurs, la France recentrera ses forces, avec le soutien de l’Europe, près des zones les plus vitales pour ses intérêts et ceux de l’Occident.
• Elle est consciente que le retrait permettra à l’influence russe et chinoise de s’accroître encore dans la région du Sahel.
• Elle est également consciente des capacités limitées des armées locales pour assurer la stabilité et la sécurité dans les pays du Sahel.
Mais, tout cela signifie ouvrir la région à une concurrence chaotique dont les répercussions seront désastreuses à l’avenir.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Mali, suivez Africa-Press