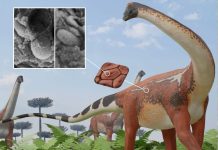Mathieu Olivier
Africa-Press – Niger. La Russie de Vladimir Poutine était le principal soutien de Bachar al-Assad, le président syrien renversé le 7 décembre. Avec sa chute, Moscou pourrait perdre, en Syrie, deux bases militaires importantes, navale et aérienne, qui lui permettaient de se projeter vers l’Afrique, notamment vers ses alliés sahéliens.
En quelques jours, Vladimir Poutine a perdu l’un de ses principaux alliés. Bachar al-Assad, que la Russie soutenait depuis plusieurs années militairement et politiquement, est finalement tombé, sous les coups de l’offensive éclair de la coalition menée par le groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTC) d’Ahmed al-Charaa. L’ancien président a pris la fuite vers la Russie, qui déclare lui avoir accordé l’asile.
Depuis ce coup de théâtre survenu dans la nuit du 7 au 8 décembre, Moscou est à pied d’œuvre pour en gérer les conséquences. Selon plusieurs observateurs russes, le Kremlin a pris contact avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan, dont le pays est l’un des principaux soutiens de la coalition rebelle, désormais aux commandes à Damas. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est aussi à la manœuvre.
Après avoir annoncé avoir accueilli Bachar al-Assad pour « raisons humanitaires », la Russie a d’ores et déjà déclaré qu’elle était favorable à une solution politique en Syrie, tentant de se poser en interlocuteur crédible des rebelles ayant pris le pouvoir. Il est pour le moment difficile de dessiner les contours de la future transition qui devrait être installée en Syrie.
Un système de projection militaire menacé
Ahmed al-Charaa, chef du HTC, a combattu dans les rangs de l’État islamique (EI), sous le nom de Abou Mohammed Al-Joulani, alors que l’organisation n’était encore qu’une branche d’Al-Qaïda en Irak. Envoyé en Syrie par Abou Bakr al-Baghdadi, il y fondera le Front al-Nosra, puis rompra en 2013 avec le futur calife de l’EI. Ces dernières années, bien que sa tête ait été mise à prix par les États-Unis, il se serait peu à peu éloigné de l’islam radical.
Ahmed al-Charaa peut-il accepter de dialoguer avec la Russie ? Selon une source citée par une agence de presse russe, Moscou a obtenu de la rébellion arrivée au pouvoir la garantie de la sécurité de ses bases militaires et de ses représentations diplomatiques en Syrie. Mais, sur le terrain, des mouvements de troupes et de matériel ont été signalés autour des emprises russes que sont la base aérienne de Hmeimim, dans la région de Lattaquié, et la base navale de Tartous.
Ces deux installations sœurs pourraient être abandonnées par la Russie, si aucun accord n’était trouvé avec Ahmed al-Charaa. Il y a quelques jours, des observateurs indiquaient d’ailleurs que les navires de guerre russes avaient quitté le port de Tartous, tandis que la zone de Lattaquié était sous le contrôle des rebelles.
Ces deux bases ont été utilisées, ces dernières années, par l’armée russe et ses supplétifs – Wagner et Afrika Corps – dans le cadre de transports de matériel et de troupes en Afrique, en particulier en Libye et au Sahel. Le ballet aérien était spécialement important entre les aéroports russes (notamment celui de Chkalovsky, près de Moscou), la Syrie et le Mali, le Burkina Faso et la Centrafrique.
L’armée russe vers Benghazi et Tobrouk ?
Des Antonov, Iliouchine ou Tupolev ont régulièrement fait la navette entre Hmeimim, Benghazi, Bamako, Ouagadougou et Bangui, dans un circuit de livraisons aux alliés africains de Moscou. C’est ce système qui pourrait être menacé par la disparition de l’emprise russe en Syrie.
Il est encore trop tôt pour mesurer les effets de l’abandon potentiel des bases de Hmeimim et Tartous – qui dépendent aussi d’autres puissances, comme les États-Unis, imprévisibles depuis la réélection de Donald Trump, et la Turquie. Néanmoins, les conséquences pourraient être particulièrement fortes en Libye, où la Russie et Wagner se tiennent aux côtés du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’est du pays, depuis des années.
Moscou pourrait décaler sa capacité de projection de la Syrie à la Libye.
Le port de Tobrouk pourrait apparaître comme une solution de repli, tout comme l’aéroport de Benghazi. « Moscou pourrait simplement décaler sa capacité de projection vers l’Afrique, de la Syrie à la Libye, en s’appuyant sur son alliance avec Haftar », confie un expert du groupe Wagner. Le vice-ministre de la Défense russe, Iounous-Bek Evkourov, a d’ailleurs multiplié les visites en Libye en 2023 et 2024.
La construction de bases russes, dont un port en eaux profondes, a été discutée avec le maréchal Haftar. Dès lors, Moscou parviendrait à conserver une installation maritime sur la Méditerranée, tout en préservant, avec Benghazi, les capacités aériennes de soutien logistique offertes à ses alliés africains. « Mais tout cela est lié à Haftar et n’offre que peu de stabilité », tempère notre source.
Port Soudan, l’autre repli espéré
Dans le même temps, la Russie a également en tête un autre point de chute en eaux profondes, qui l’intéresse depuis plusieurs années: Port-Soudan, sur les rives de la mer Rouge. Un accord pour cette installation aurait été trouvé ces derniers mois avec le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan, engagé dans une guerre civile contre les rebelles du général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemetti.
Ce projet pourrait toutefois mettre du temps à se concrétiser, la guerre soudanaise durant depuis maintenant un an et demi. « Si la Russie parvient à ouvrir des bases navales à Port-Soudan et à Tobrouk, elle aura finalement gagné en influence au niveau maritime, en plaçant deux enclaves des deux côtés du canal de Suez, explique notre source. Quant aux rotations aériennes de l’armée russe, elles peuvent sans doute tout à fait s’opérer depuis Benghazi. »
Sur l’une des chaînes Telegram du groupe Wagner, un analyste russe livre, ce 9 décembre, le même constat, déplorant la perte potentielle de la « plateforme logistique » de Hmeimim, qui « pourrait porter un coup dur, non seulement à nos positions au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique ». « Il convient d’envisager des options logistiques alternatives pour nos opérations africaines: […] la Libye et […] Port-Soudan », ajoute-t-il.
Au niveau logistique, Moscou semble donc capable de trouver des solutions africaines. En revanche, la chute de Bachar al-Assad aura sans doute un impact symbolique et diplomatique plus important. Mobilisée par sa guerre en Ukraine, la Russie a en effet affiché son incapacité à sécuriser le pouvoir d’un allié qu’elle soutenait pourtant envers et contre tous depuis 2015.
Au-delà de la logistique, une défaite symbolique
Bachar al-Assad et la Syrie faisaient en effet partie, depuis plusieurs années, d’un narratif victorieux développé par Moscou et Wagner. « Les Russes mettaient leur intervention en Syrie en avant pour démontrer leur efficacité, et celles de leurs mercenaires, à combattre et à soutenir leurs alliés, explique notre expert du groupe Wagner. Ce discours ne pourra plus être tenu à partir de maintenant. »
L’incapacité à sauver Assad est un mauvais message envers les alliés sahéliens de Poutine.
Confrontés à des mouvements rebelles sur leur sol (qu’ils soient islamistes ou non), les alliés de Vladimir Poutine en Afrique – Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Abdourahamane Tiani au Niger, Faustin-Archange Touadéra en Centrafrique – ont sans aucun doute suivi de près les événements de ces derniers jours en Syrie, accréditant l’idée d’un géant russe aux pieds d’argile.
« Il y a encore quelques jours, tout le monde s’attendait à ce que Vladimir Poutine envoie des troupes et des mercenaires soutenir Bachar al-Assad, en Syrie, face à la rébellion. Or, soit il ne l’a pas voulu, soit il en a été incapable en raisons des limites de l’armée russe. Dans les deux cas, c’est un mauvais message envers ses alliés sahéliens », analyse un diplomate en poste en Afrique de l’Ouest.
« Comme Bachar al-Assad le faisait, Assimi Goïta combat ce qu’il considère comme une coalition de forces rebelles, dont des mouvements jihadistes, poursuit le diplomate. Si celle-ci se formait réellement et venait à avancer vers Bamako et à menacer la capitale, est-ce que les Russes feraient la même chose qu’en Syrie ? La junte malienne doit forcément se poser cette question depuis quelques jours. »
Source: JeuneAfrique
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Niger, suivez Africa-Press