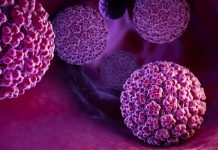Africa-Press – Benin. Le « bâtiment bleu » de l’hôpital Broca, dans le 13e arrondissement de Paris, abrite de curieux personnages. Dans une pièce ronde et vitrée, les résidents des différents services de gériatrie peuvent rencontrer Nao, Pepper, ou encore Paro. Ce dernier, en forme de bébé phoque, est particulièrement sollicité. « Les patients le prennent dans les bras ou sur leurs genoux, et le caressent, explique Lauriane Blavette, ingénieure de recherche au Broca Living Lab. Avec ses capteurs, il ressent la pression des mains, et y réagit. Cela crée une interaction avec les patients, qui parfois sont restés renfermés plusieurs semaines. »
Ces robots sociaux sont au cœur d’études expérimentales. Au Broca Living Lab (AP-HP/ Université Paris-Cité), psychologues, ingénieurs et soignants dirigent des projets pour améliorer leur usage dans les établissements de soins. « Ici, nous nous intéressons particulièrement aux nouvelles technologies, et à leur usage dans l’accompagnement des personnes âgées, des proches aidants et des professionnels de gériatrie », souligne Maribel Pino, psychologue clinicienne et directrice du laboratoire.
« Devine quelle émotion je mime ! »
Dans les établissements de santé, les robots sociaux sont déjà intégrés à des thérapies non-médicamenteuses, pour tester la mémoire des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou guider des activités d’animation par exemple. « Nao est particulièrement utilisé avec les personnes âgées, et les enfants atteints de troubles autistiques, poursuit Lauriane Blavette. Il peut danser, chanter, faire des jeux pour travailler la mémoire ou la reconnaissance des émotions. »
Mais Nao ne communique pas vraiment: tout est programmé à l’avance sur l’application Zora. Les commandes sont simples d’utilisation, pour permettre aux professionnels de guider les animations. Il suffit à la chercheuse d’appuyer sur un bouton pour lancer le jeu. « Devine quelle émotion je mime ! »lance Nao, avant d’interpréter successivement la tristesse, la peur et le soulagement. « On appelle cela la technique du Magicien d’Oz, explique la chercheuse. Tout laisse penser que Nao est autonome, mais ses actions sont programmées en amont par un humain sur un ordinateur auquel il est relié. »
Sur la photo, de gauche à droite, en haut: Pepper, Nao, JoyforAll (robot chat). En bas: Nao (avec l’application Zora), Robot chien et Paro.
Que la réponse soit bonne ou mauvaise, Nao ne la comprend pas, mais l’illusion d’interaction suffit. « Un jour, une résidente aphasique (qui ne parle pas, ndlr) avait un robot chat sur ses genoux, qu’elle caressait, raconte Lauriane Blavette. Nous avons programmé Nao pour dire « au revoir » en chanson, la dame s’est mise à chanter avec Nao du début à la fin, en disant au robot chat de se taire pour l’écouter ! »
À travers différentes études, les chercheuses évaluent l’utilisation de ces robots. Maribel Pino a participé à l’expérimentation ROSIE, un état des lieux national de l’utilisation des robots sociaux dans 59 établissements gériatriques. « On a remarqué que malgré une amélioration de l’état clinique des résidents grâce à l’utilisation des robots sociaux, les pratiques sont très hétérogènes, par manque d’encadrement », raconte la directrice du Broca Living Lab.
Vers un usage plus éthique
Doctorante au Sorbonne Center for Artificial Intelligence (Sorbonne Université), Meriem Beghili consacre sa thèse aux problèmes éthiques posés par ces interactions, comme le risque d’un trop grand attachement. « Parfois, les patients confondent le robot avec un être vivant. Il devient alors difficile de leur faire comprendre que cette relation est unilatérale ». Elle cite également d’autres risques, comme l’infantilisation du patient, ou les questions autour de l’autonomie et du consentement, qui n’est pas toujours formulé explicitement. Du côté des professionnels, la peur d’être remplacés par les robots intervient souvent.
Pour Serge Tisseron, psychiatre et membre de l’Académie des technologies, il est indispensable de « mettre les professionnels au cœur de la création de protocoles ». En secondant le soignant sans l’exclure, le robot trouve sa place dans la relation de soin. « Le robot est un très bon outil de médiation thérapeutique, mais il faut veiller à ne surtout pas l’humaniser, ni le créditer de plus de compétences qu’il n’en a », conclut-il. Pour le psychiatre, les prochains questionnements éthiques porteront surtout sur le développement des modèles de langage de l’intelligence artificielle.
Une perspective également anticipée par Maribel Pino: « Depuis deux ans, de nouveaux robots avec un grand modèle de langage (LLM en anglais) arrivent sur le marché. Notre avis est ambivalent. D’un côté, ces robots offrent beaucoup plus d’opportunités d’interactions que les robots programmables comme NAO. Mais en contrepartie, ils ont une grande autonomie, qui peut s’avérer dangereuse à l’hôpital, avec des populations vulnérables. La question, c’est où placer le curseur du contrôle ? Acceptons-nous de contrôler seulement partiellement le robot ? »
Aujourd’hui, les robots avec LLM sont employés dans certains établissements, ou dans un cadre expérimental, mais rarement au contact des patients seuls. « Ces robots sont souvent utilisés pour l’accueil et l’assistance, pas dans un cadre thérapeutique », précise la psychologue.
Accompagner les soignants sans les remplacer
Pour le moment, il n’existe pas de réglementation sur l’utilisation de robots sociaux dans les établissements de santé. « L’AI Act (le cadre réglementaire européen sur l’IA adopté en 2024, ndlr) nous oblige, comme dans tous secteurs, à assurer la transparence et l’utilisabilité des outils, mais cela ne sera pas suffisant », résume Maribel Pino, psychologue et directrice du Broca Living Lab. Aussi les professionnels fonctionnent surtout au cas par cas, que ce soit pour introduire ou retirer le robot.
Pour faciliter l’intégration du robot dans la relation de soin, Maribel Pino et son équipe du Broca Living Lab produisent des recommandations éthiques. « Dans nos pratiques, le robot garde toujours le statut d’objet médiateur, explique la chercheuse. On demande l’accord des résidents pour interagir avec la machine. Ce sont même eux qui appuient sur le bouton pour l’allumer et l’éteindre. Lorsqu’ils demandent où est NAO, on leur répond qu’il est rangé dans sa boîte. En général, cette réponse leur suffit et ne provoque pas d’émotion négative. »
La chercheuse teste une borne interactive destinée à l’accueil des patients et leurs proches, mais aussi à des exercices pour travailler la mémoire. Grâce à son système d’intelligence artificielle, la borne suit les mouvements de son interlocutrice des yeux. Crédits: Enola Tissandié
Le projet Robethics est spécialement fait pour aider les professionnels de santé à manier les robots. « En étant à l’aise avec l’outil, ils perdent moins de temps lors de l’installation et en comprennent mieux les enjeux », précise Lauriane Blavette. Le projet se décline en plusieurs vidéos illustrant chacune une interaction avec le robot: comment l’allumer avec le patient, comment réagir face à un refus ou une situation d’attachement… Autant de situations que peuvent rencontrer les professionnels, sans avoir de directives données par les développeurs des robots. « Ces derniers ont des inquiétudes techniques, qui portent sur le bon fonctionnement du robot, poursuit la chercheuse. Mais pour les usagers, les inquiétudes sont différentes. La mauvaise prononciation des noms propres peut altérer l’interaction thérapeutique. »
Au plus près des robots et des usagers, les chercheuses du Broca Living Lab espèrent que les recommandations tirées de leurs expérimentations pourront servir à un cadre plus général de la robotique sociale à l’hôpital.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Benin, suivez Africa-Press