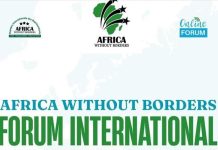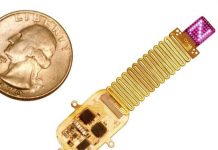Africa-Press – Comores. Nous connaissons tous quelqu’un dans notre entourage plus ou moins proche qui enchaîne les compétitions extrêmes, trails, Ironman (triathlon long de 226 km) ou, tout simplement, la pratique excessive d’un sport. S’il est souhaitable de pratiquer une activité physique régulière, quand celle-ci échappe au plaisir et devient un besoin vital cela soulève la question de l’addiction. Car la bigorexie, l’addiction au sport, est une addiction au même titre que la drogue, la cigarette ou encore l’alcool.
Comme toutes les addictions, la bigorexie peut conduire à un isolement social, à la prise de produits dopants et au besoin compulsif de faire de l’exercice. Ce surinvestissement sportif pathologique trouve ses racines d’abord dans la promotion sociale de la performance, la culture du dépassement de soi, la culture de l’image accentuée par les réseaux sociaux. Mais lorsque la pratique sportive devient un besoin parfois quotidien plus qu’un plaisir, le risque de glissement vers la dépendance est réel. Les sportifs ne se rendent pas toujours compte de leur addiction au sport et c’est souvent l’entourage qui sonne l’alerte face à une situation de plus en plus déviante et la multiplication des blessures.
Dix critères
Le docteur Dan Velea, psychiatre-addictologue, dit que la bigorexie est une addiction sans drogue, une addiction comportementale qui consiste en une pratique excessive de l’exercice physique, sans limite de temps et de condition physique, avec perte d’autres centres d’intérêt. Il définit dix critères de la dépendance à l’exercice. Le premier est la réduction du répertoire des exercices conduisant à une pratique stéréotypée et quotidienne. L’activité physique est plus investie que toute autre activité, l’intensité de l’exercice augmente année après année. Des symptômes de sevrage avec tristesse existent lors de l’arrêt de l’activité physique, qu’il soit volontaire ou contraint. Ces symptômes disparaissent lors de la reprise de l’exercice.
En outre, ceux qui souffrent de bigorexie ont une perception subjective d’un besoin compulsif d’exercice et ils retrouvent rapidement leur activité compulsive après une période d’interruption. Et ils ont une fâcheuse tendance à poursuivre une pratique sportive intensive en dépit de maladies physiques graves plus ou moins causées par le sport, ils négligent ainsi les avis médicaux. Enfin, des difficultés, voire des conflits familiaux, peuvent surgir, liés à la pratique sportive, ainsi qu’une perte de poids dans l’unique et seul objectif d’améliorer ses performances.
Une maladie multifactorielle
L’addiction à l’exercice physique cherche le plus souvent à améliorer l’estime de soi. Dan Velea évoque la possibilité de troubles narcissiques, mais aussi le besoin permanent de nouveaux challenges. Enfin, pour certains, il s’agit d’une autothérapie face au mal de vivre. La bigorexie peut avoir de sérieuses répercussions dans la vie sociale et quotidienne, les loisirs deviennent presque exclusivement liés à la pratique sportive et tout l’environnement se recentre peu à peu autour de ce centre d’intérêt. Ce phénomène touche particulièrement les coureurs ainsi que les bodybuilders, mais aussi les sportifs de haut niveau, aussi bien en activité qu’à la retraite.
Et il existe des facteurs favorisants comme le statut familial, ainsi la prévalence serait plus importante chez les sportifs veufs ou divorcés ainsi que les célibataires et, plus largement, chez les personnes souffrant d’isolement social et de difficultés psychologiques. D’autres facteurs de vulnérabilité existent comme l’introversion, l’anxiété ou encore le perfectionnisme. La prévalence de l’addiction au sport serait de 10 %.
Des symptômes de manque
Les conséquences sur le corps sont multiples, chez les femmes peuvent apparaître des troubles menstruels et une baisse de la densité osseuse, et chez l’ensemble des sportifs un processus d’addiction à certains neurotransmetteurs se met en place. C’est une forme de dopage aux endorphines, à la sérotonine et à la dopamine et, comme dans tout processus d’addiction, il y a accoutumance ce qui conduit à accroître toujours plus ses efforts pour espérer ressentir les bienfaits des neurotransmetteurs cérébraux. Sans cela, des symptômes de manque peuvent apparaître : tremblements, maux de tête, irritabilité ou insomnies.
De gros efforts restent à fournir pour dépister les individus souffrant de bigorexie afin de mieux les prendre en charge en évaluant le profil de personnalité des sportifs addicts. Plus spécifiquement, les sportifs de haut niveau doivent bénéficier d’un accompagnement spécialisé dans leur reconversion à l’arrêt de la compétition. Médecins addictologues, psychothérapeutes ou psychologues du sport sont des interlocuteurs parfaitement formés à la prise en charge de cette nouvelle forme d’addiction.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Comores, suivez Africa-Press