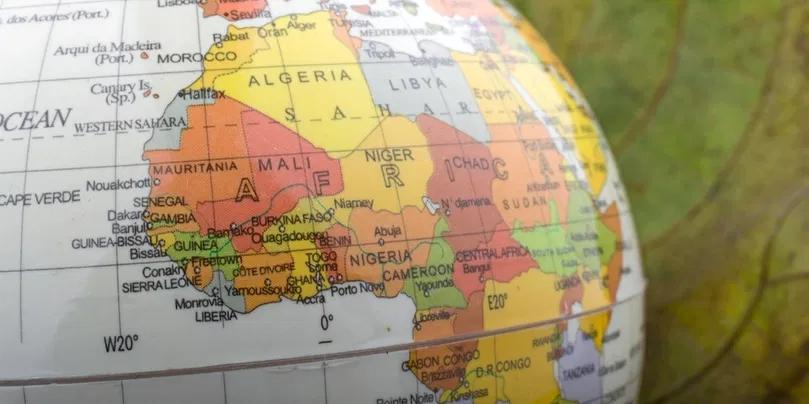Africa-Press – Côte d’Ivoire. Clôturé après 61 ans, ce chantier colossal redonne au continent sa place au cœur du récit mondial et des savoirs partagés.
C’est un projet dantesque qui vient de s’achever le 17 octobre dernier, à Paris, avec la parution des trois derniers volumes de L’Histoire générale de l’Afrique. Lancée en 1964 par l’Unesco, au moment des indépendances africaines, cette œuvre pionnière vise à raconter l’histoire de l’Afrique du point de vue africain, en faisant fi des mythes et idées préconçues entourant le continent. L’ampleur de ce travail qui a mobilisé sur 61 ans plus de 550 experts, dont la majorité issue d’Afrique, reste inégalée.
Un comité scientifique de plus de 200 chercheurs, mis sur pied en 2013, a coordonné la rédaction de ces trois derniers tomes. Ceux-ci s’attachent dans un premier ouvrage à une remise à jour des volumes précédents publiés entre 1964 et 1994, donnent dans un second la part belle aux diasporas africaines ainsi qu’à leurs précieux apports, et enfin s’intéressent aux défis contemporains de cette « Afrique globale » actuelle. Au total, les onze volumes produits couvrent la période depuis les origines de l’humanité jusqu’aux défis contemporains des Africains et des diasporas dans le monde. Un projet académique d’envergure, mais également une ressource pédagogique précieuse.
Œuvre pionnière contre les préjugés
« L’ambition de ce projet est directement liée au contexte de l’époque. Dès le départ, il s’agissait de rendre à l’Afrique son passé véritable. Pour les Africains, cela consistait à affirmer leurs identités culturelles, exposer la pensée africaine, ses civilisations, ses sociétés et institutions dans leur diversité et réaffirmer leur aspiration à l’unité africaine », relate Lamine Diagne, spécialiste des programmes à l’Unesco. Ce qu’il appelle « l’une des entreprises intellectuelles les plus ambitieuses du XXe siècle » ambitionnait de reconstruire l’histoire du continent en remettant en cause les approches conventionnelles. Celles-ci, basées sur un regard colonial pétri de mythes, préjugés et stéréotypes racistes, occultaient ainsi la véritable Histoire du continent et perpétuaient l’idée répandue selon laquelle l’Afrique n’était pas encore entrée dans l’Histoire. Une ignorance encore remise au goût du jour par Nicolas Sarkozy lors de son discours à Dakar en 2012, oubliant même que l’Afrique est le berceau de l’humanité. À travers ce projet, il s’agit de réhabiliter la vérité historique mais aussi la mémoire historique, et rappeler la contribution essentielle du continent à l’Histoire universelle et « son apport au progrès général de l’humanité ».
À rebours des idées reçues « selon lesquelles les sociétés africaines ne pouvaient faire l’objet d’une étude scientifique, faute notamment de sources et de documents écrits », comme le rappelle M. Diagne, le projet de l’Unesco intègre les traditions orales aux archives écrites, aux recherches scientifiques et découvertes archéologiques. Un travail de titan qui va s’étaler sur 61 ans et va devoir surmonter de nombreux obstacles, tant financiers, qu’organisationnels, ou encore liés à la recherche. Assuré initialement par l’Unesco, « le financement se relève insuffisant par rapport à l’ampleur du travail, notamment du fait de l’envoi de missions de collecte d’archives à travers le monde (création de deux centres à Niamey et Dar-es-Salam), entraînant le recours à des fonds extrabudgétaires » développe le spécialiste. Au niveau de l’organisation, la coordination d’un réseau immense de chercheurs dispersés, aux approches différentes et parlant plusieurs langues, s’avère un défi. Auquel s’ajoute le fait pour de nombreux chercheurs africains d’avoir à « composer avec un accès limité aux archives, à la bibliographie et aux infrastructures de recherche » et les contraintes logistiques de l’époque. Malgré tous ces obstacles, le projet se réalise.
Après un arrêt de plusieurs années après la publication du tome huit, le projet d’écriture de trois nouveaux tomes afin de couvrir l’histoire récente et poursuivre le récit émerge en juin 2009 à la demande des chefs d’État et gouvernement de l’Union africaine. Après une réunion d’experts à Addis-Abeba en juin 2013, un nouveau comité scientifique international, de 16 membres, est mis en place en 2014, tandis que des nouveaux fonds sont engagés. Une accélération notamment impulsée ces dernières années par la directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay.
Rôle crucial des diasporas africaines
Ces trois nouveaux tomes continuent de célébrer les peuples africains et leurs apports au monde. Le tome dix est consacré aux diasporas africaines « pour restituer la dimension mondiale de l’expérience africaine et dépasser une vision strictement continentale de son histoire », développe Lamine Diagne. « Les diasporas ont été, depuis des siècles et sur tous les continents, des acteurs majeurs des échanges culturels, économiques et spirituels entre l’Afrique, les Amériques, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie. En retraçant la diversité de ces expériences (esclavage, migrations volontaires, circulations savantes ou marchandes), le volume met en évidence une identité diasporique plurielle mais unie par un même combat pour la dignité. Aujourd’hui, ce travail entrepris par l’Unesco est d’autant plus pertinent, car reconnaître la profondeur historique des diasporas africaines revient à affirmer leur rôle dans la construction du monde moderne », insiste-t-il. Le continent occupe une place historique mondiale primordiale, sa contribution persistante se manifestant par le commerce, les migrations, les avancées scientifiques et les échanges culturels qui créent des liens intercontinentaux durables.
Le dernier ouvrage enfin explore les défis et opportunités actuels auxquels l’Afrique moderne est confrontée. Les grandes évolutions sociales, politiques et culturelles, tant sur le continent que celles vécues par les diasporas africaines dans le monde, sont étudiées. L’égalité de genre, la mondialisation, le changement climatique, le panafricanisme, la santé publique… sont parmi les nombreux sujets contemporains développés par les experts dans ce volume final. En arrière-plan, c’est une réflexion sur la mémoire, l’identité et l’avenir de l’Afrique qui est aussi évoqué.
Ressource pédagogique
Œuvre majeure d’un point de vue académique, c’est aussi et surtout une ressource pédagogique à la portée universelle. Si Lamine Diagne assure que « les précédents volumes ont été reçus avec enthousiasme par les publics atteints et ont introduit une nouvelle manière de voir le passé du continent en produisant un changement radical dans la compréhension du passé africain », leur diffusion reste à amplifier.
De nombreux publics n’y ont pas encore eu suffisamment accès. Le travail de diffusion et de vulgarisation est donc essentiel. L’Histoire générale de l’Afrique a été publiée en 13 langues parmi lesquelles trois langues africaines (peul, haoussa et kiswahili). Les premiers volumes sont aussi disponibles gratuitement sur le site de l’Unesco et les derniers parus devraient l’être prochainement également. L’Organisation des Nations unies a aussi conçu plusieurs ressources comme le Curriculum Pathway Tod, des sortes de guides pédagogiques avec des plans de cours pour les enseignants. Un jeu vidéo, Héros Africains, a aussi été conçu autour de dix figures africaines emblématiques (Toussaint Louverture, la reine Nzinga entre autres) issus de cinq sous-régions de l’Afrique et de différentes périodes historiques, pour diffuser plus largement les connaissances en rendant l’apprentissage interactif. Un réseau d’universités a été créé pour promouvoir l’utilisation de l’Histoire générale de l’Afrique dans l’enseignement supérieur, renseigne enfin M. Diagne.
lepoint
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press