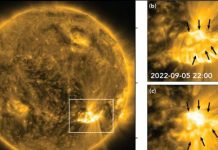Africa-Press – Côte d’Ivoire. Comme un symbole, le 21e siècle s’est ouvert avec le premier séquençage complet du génome humain en 2001 – officiellement en 2003. L’aboutissement d’un siècle de recherche fondamentale ayant posé les fondations d’une science nouvelle: la génétique. Inédite, cette lecture intégrale des trois milliards de lettres (combinaisons des nucléotides A, C, G, T) composant un ADN humain permettait de dénombrer pour la première fois quelque 21.000 gènes.
Le fruit d’un vaste programme de recherche international entamé en 1988, le Human Genome Project, qui aura, en quelque sorte, fait entrer notre siècle dans le vif du sujet de la génétique. Car une fois lu ce code source de l’humanité, inscrit dans le noyau de chaque cellule, il devenait permis de rêver à son décryptage pour comprendre comment il s’articule avec l’activité biologique d’un organisme, en particulier lorsque celui-ci est frappé de maladie. Et donc, pourquoi pas, le réécrire avec précision?
Pour mémoire, les 23 paires de chromosomes présents dans chacune de nos cellules sont constituées d’ADN. Cet acide désoxyribonucléique est lui-même composé d’un enchaînement de molécules organiques, les nucléotides: adénine (A), cytosine (C), guanine (G), thymine (T). Un gène correspond à une séquence de nucléotides combinés pour « coder une protéine » ; autrement dit, un plan permettant à une cellule de fabriquer une protéine nécessaire au fonctionnement de l’organisme.
Par exemple, le gène HBB situé sur le chromosome 11 code l’hémoglobine, protéine essentielle aux globules rouges pour transporter l’oxygène dans le sang. Lorsque ce gène est muté, la protéine produite n’est pas fonctionnelle et empêche donc le sang d’oxygéner les organes… C’est la drépanocytose. Soit la maladie génétique la plus répandue au monde: 300.000 naissances par an pour 6 à 9 millions de malades – entre 20.000 et 30.000 personnes en France. Pour la guérir, il suffirait d’intervenir sur quelques lettres du génome seulement.
C’est bien ce qu’aura permis la découverte de ce quart de siècle en biologie: Crispr-Cas9 (prononcez « crispeur casse neuf »), en 2012. Le fameux couper/coller de la génétique, facile d’utilisation, peu coûteux, simplifie et libère la recherche comme peu de découvertes le font. Fait rare: il n’a fallu que huit ans au comité Nobel pour prendre acte de l’impact majeur de Crispr-Cas9 et attribuer le prix de chimie 2020 à ses codécouvreuses: la Française Emmanuelle Charpentier et l’Américaine Jennifer Doudna. « La vitesse à laquelle la communauté scientifique s’est approprié la technologie pour l’améliorer, la modifier et en étendre ses applications est juste exceptionnelle », nous confirmait alors Alexis Verger, chargé de recherche CNRS en biologie structurale intégrative à l’université de Lille.
La technologie en question, Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna la découvrent en étudiant le système immunitaire de micro-organismes. Nombre d’espèces bactériennes disposent, dans leur génome même, d’un système d’autocorrection de l’ADN ultra-précis, qui peut servir de biotechnologie pour supprimer, ajouter ou remplacer un ou plusieurs gènes sur n’importe quel autre organisme.
Un tollé mondial dans le milieu de la bioéthique
D’autres techniques d’édition génétique existaient avant et sont encore utilisées, comme les vecteurs viraux – un virus inoffensif équipé d’un gène-médicament à délivrer dans les cellules qu’il infecte. Mais le système Crispr est à la fois plus accessible financièrement, plus polyvalent et plus précis. Au point d’emballer la machine.
Dès avril 2015, l’équipe de Junjiu Huang à l’université Sun Yat-Sen (Chine) annonce la première modification du génome sur des embryons humains – non viables. L’annonce ébrèche le tabou d’une possible ingénierie génétique de l’humain. Car modifier des embryons, c’est transmettre cette modification à leur possible descendance. À l’époque, le neurobiologiste Hervé Chneiweiss, alors président du comité d’éthique de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), s’insurgeait dans nos colonnes: « On ne joue pas avec des embryons humains […] Cela n’apporte strictement rien à la connaissance du génome, sur le plan scientifique. C’est juste pour la prouesse technique. » En l’occurrence, l’étude révéla que l’édition du gène HBB – celui de la drépanocytose, déjà – n’avait fonctionné que pour 28 embryons sur 71.
Mais deux ans plus tard, en 2017, l’université médicale de Canton (Chine) annonce les premières modifications sur des embryons, viables cette fois… et l’opération – toujours sur la drépanocytose – a bien mieux fonctionné ! Le débat qui s’était ouvert penche désormais vers l’autorisation d’éditer des embryons jusqu’à 7 à 14 jours, à des fins de recherche uniquement. Ne serait-ce que pour apprendre à maîtriser l’outil. D’autant qu’on lui découvre une fâcheuse tendance à introduire dans le génome des modifications non ciblées, dites « off target » (« hors cible » en français).
Cela n’empêchera pas He Jiankui, 34 ans, de franchir la ligne rouge de tous les comités d’éthique du monde, y compris en Chine. Le 19 novembre 2018, à la veille de l’ouverture du Sommet international de l’édition du génome humain à Hong Kong, le jeune professeur de l’université des sciences et des technologies du Sud à Shenzhen (Chine) annonce la naissance un mois plus tôt de jumelles issues d’embryons génétiquement modifiés. Et provoque un tollé mondial, en particulier dans le monde de la bioéthique. En Chine, ses travaux sont stoppés, He Jiankui disparaît même quelques semaines… avant de réapparaître en résidence surveillée.
Première thérapie cellulaire contre la drépanocytose
Les enquêtes menées par l’université et le gouvernement chinois révèlent une troisième naissance, Amy, en 2019. En décembre, He Jiankui est condamné à trois ans de prison et 400.000 euros d’amende. Quant aux jumelles génétiquement modifiées, anonymisées sous les prénoms de Lulu et Nana, elles sont le fruit d’un couple de volontaires dont le père est séropositif au VIH. Après une fécondation in vitro, He Jiankui a utilisé Crispr-Cas9 pour modifier le gène CCR5 qui code une protéine utilisée par le VIH pour pénétrer les cellules.
Cette mutation CCR5-delta32 est connue pour conférer une immunité forte au virus du sida. C’est celle-ci qu’auraient reçue les petites filles âgées aujourd’hui de 6 ans et demi. Mais impossible de recouper l’information. Il faut croire He Jiankui sur parole, qui n’a jamais publié les données de son expérience. « Les fillettes vivent une vie parfaitement normale, paisible et heureuse », assurait-il en 2023 dans Les Échos. Et comme l’existence de Lulu, Nana et Amy est avérée par les autorités chinoises, il faut se rendre à l’évidence: Crispr-Cas9 a fait basculer le 21e siècle dans une nouvelle ère de la génétique en offrant « le redoutable pouvoir de contrôler l’évolution », selon l’expression de Jennifer Doudna.
De façon plus prosaïque, à la paillasse, dans des cadres éthiques respectés, les progrès fulgurants des techniques génétiques laissent entrevoir de meilleurs auspices. Comme la première thérapie cellulaire curative contre la drépanocytose, homologuée en 2023 sous le nom de Casgevy. Le traitement consiste à prélever des cellules souches sanguines au patient pour les éditer génétiquement de sorte qu’elles (et leur très longue descendance) produisent plus d’hémoglobine, la protéine manquante. Puis de réinjecter les cellules modifiées. Coût: deux millions d’euros. Il s’agit du seul traitement utilisant Crispr autorisé à ce jour.
Trouver le bon gène à corriger dans une machinerie complexe
Les connaissances acquises en accéléré sur le génie génétique depuis 2012 ont aussi révélé l’incroyable complexité de la machinerie moléculaire des cellules. Les maladies monogéniques, dues à un seul gène muté, sont plutôt l’exception, comme la mucoviscidose et son gène CFTR, en ligne de mire de la recherche. Mais lorsqu’une maladie implique des dizaines ou centaines de gènes, encore faut-il savoir quoi corriger dans le code. Alors que le séquençage complet d’un génome humain se fait désormais en 48 heures pour 1000 euros, le décryptage fin reste délicat. Même si l’intelligence artificielle a déjà accéléré les choses.
En attendant, Crispr et les techniques encore plus perfectionnées développées à sa suite permettent aux chercheurs de développer à la demande des modèles cellulaires ou animaux pour l’étude des cancers, des maladies cardiaques, d’Alzheimer ou Parkinson, les tests de molécules, etc. Le génome humain n’est plus la boîte noire de l’an 2000, mais un livre ouvert dont il reste à saisir tous les tenants et les aboutissants, pour que chaque réécriture envisagée soit pertinente et faite en sécurité.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press