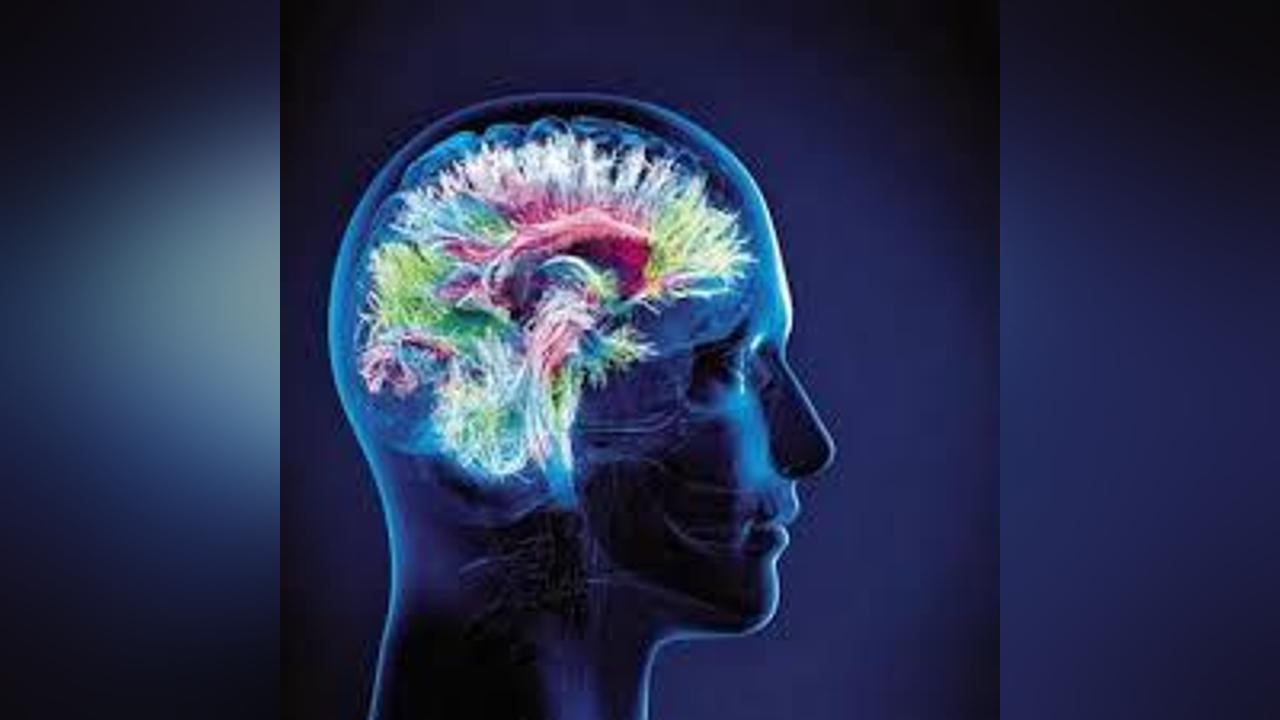Africa-Press – Côte d’Ivoire. Étudiante en droit, Fiona (son prénom a été modifié) s’installe dans le bureau de la neuropsychologue Léa Coquerel, à l’unité mixte de recherche 1077. Elle participe au projet Times, une étude qui porte sur la mémoire temporelle: comment percevons-nous et mémorisons-nous le temps? Nos performances s’affaiblissent-elles avec l’âge?
Ce laboratoire mixte Inserm-université de Caen Normandie-École pratique des hautes études, situé sur le campus de la fac de médecine caennaise, est, avec le centre Magendie, à Bordeaux, l’un des hauts lieux de l’étude de la mémoire en France. Ici, on l’explore sous toutes ses coutures depuis plus de vingt ans: « normale » comme celle de Fiona, pathologique (maladie d’Alzheimer, amnésies, trouble de stress post-traumatique [TSPT], etc.), individuelle ou collective.
À quelques encablures de l’unité 1077, où sont réalisés les bilans neuropsychologiques et les EEG (électroencéphalogrammes), la plate-forme Cyceron offre aux chercheurs l’accès à de puissants imageurs: IRM (imagerie par résonance magnétique) pour visualiser les zones du cerveau activées lors de la réalisation d’une tâche – de mémoire, par exemple – et TEP (tomographie par émission de positons) ou PET-scan pour voir les échanges de neurotransmetteurs – les messagers chimiques – entre les neurones.
Dans un bâtiment voisin appartenant au CHU Caen Normandie, la psychologue Laura Charretier a mis au point avec le service de psychotraumatologie un livret d’information sur le TSPT. « Grâce à ce lien avec la clinique, nous balayons le champ d’étude de la mémoire, du fondamental au développement d’outils d’aide à la décision pour les soignants » , se félicite Francis Eustache, qui a dirigé l’unité 1077 de 2002 à 2021 avec Béatrice Desgranges avant d’en céder les rênes à Hervé Platel, spécialiste des liens entre mémoire et musique.
Aujourd’hui, ce sont donc les énigmes de la mémoire temporelle qui sont scrutées par le projet Times, lancé en décembre 2024 par le chercheur Inserm Thomas Hinault qui a rejoint l’unité 1077 fin 2019. Car qui n’a jamais oublié un rendez-vous, ou bien sous-estimé la durée nécessaire pour s’y rendre? Ces erreurs posent en creux la question de notre rapport au temps, une question qui taraude le chercheur depuis ses études. « Le cerveau fonctionne de manière temporelle: pour accomplir une tâche cognitive, il synchronise l’activité de groupes de neurones, à un rythme plus ou moins rapide. Or ce fonctionnement détermine la manière dont nous percevons et mémorisons le passage du temps. Pourtant, lors des consultations qui évaluent les troubles de la mémoire, la seule question de nature temporelle porte sur la date du jour. Le temps a été oublié par les études sur la mémoire », observe le scientifique, qui entend bien remédier à cette carence avec Times.
D’autant que « notre capacité à évaluer la durée d’un événement passé ou à le placer sur notre frise temporelle diminue avec l’âge ». Thomas Hinault cherche à comprendre pourquoi. Car quand la mémoire temporelle flanche, on oublie peu à peu des actes de la vie quotidienne (manger, prendre des médicaments, aller chercher ses petits-enfants…), et l’on finit par perdre son autonomie. Avec l’augmentation de la longévité, ce déclin devient un enjeu de santé publique.
Fiona fait partie du groupe contrôle de Times, des jeunes âgés de 20 à 35 ans, sans problème de santé. Leurs performances cognitives et leurs images cérébrales seront comparées à celles du groupe cible, 80 personnes de 60 à 85 ans, en bonne santé elles aussi. Pour la première partie de l’étude, qui comporte deux séances, tous suivront le même protocole. Ainsi, avant son entretien avec Léa Coquerel, Fiona s’est d’abord retrouvée au centre Cyceron, aux côtés de Paul, 70 ans, arrivé une heure en avance. À 23 ans, plongée dans ses révisions, Fiona oublie parfois un repas. Quant à Paul, depuis qu’il est retraité, il a perdu ses repères temporels. Toujours en avance, il a pourtant raté le train l’autre jour. Serait-ce parce qu’il vieillit?
Dix jours plus tôt, les deux volontaires ont été briefés par téléphone. On leur a expliqué le protocole: deux séances de trois à quatre heures, espacées d’au moins une journée. La première avec un casque EEG sous IRM, la seconde avec le PET-scan après injection d’un radiotraceur pour pister la dopamine, essentielle à la mémorisation. Une consultation sur la mémoire temporelle ponctuera ces deux demi-journées.
Comme deux précautions valent mieux qu’une, la première séance commence par une visite médicale comportant une évaluation cognitive globale (mémoire, attention, raisonnement) relativement facile. Fiona obtient un score de 27 sur 30, Paul 28. Le minimum requis est de 26, quel que soit l’âge. Le médecin valide aussi leur état de santé et l’absence sur eux d’objet métallique, contre-indiqué en raison du champ magnétique de l’IRM. S’il n’y a rien à signaler, il signe le document d’inclusion. L’expérience peut commencer.
Une succession de carrés et de triangles pour mettre la mémoire à l’épreuve
Toute souriante, la manipulatrice en radiologie Christelle Lebouleux installe Fiona dans une petite salle voisine de l’IRM. On coiffe l’étudiante d’un bonnet d’EEG doté de 128 électrodes préalablement humidifiées, un modèle spécialement conçu pour être compatible avec l’aimant de l’appareil. Ce bonnet est connecté à un ordinateur afin que Fiona puisse s’entraîner. Elle apprend à réaliser trois tâches qu’elle devra répéter une fois dans l’IRM.
La première concerne la mesure du temps: un premier carré de référence s’affiche pendant quelques secondes, une durée qu’elle ne connaît pas. Puis d’autres s’affichent entre 0,5 et 4 secondes: à chaque fois, elle doit déterminer, en appuyant sur un bouton, si cette durée est égale à la référence. Au début, Fiona est stressée, elle se trompe. À force de répétitions, elle s’améliore. La voilà prête pour la deuxième tâche – le même exercice mais portant cette fois sur la couleur d’un carré: les carrés présentés par la suite sont-ils ou non de la même couleur? Si les chercheurs détectent une différence significative entre ces deux tâches, peut-être est-ce à cause d’une propriété spécifique à la mémorisation du temps.
Enfin, pour la troisième tâche, Fiona doit évaluer si un carré affiché avant un triangle est resté plus longtemps que celui-ci à l’écran. Ce qui impose de garder en mémoire deux choses: la durée de l’affichage du triangle et celle du carré qui l’a précédé. À nouveau, elle y parvient de mieux en mieux après une phase d’entraînement. La voici prête pour la suite.
Christelle Lebouleux aide la jeune femme à s’allonger dans l’IRM, toujours avec le bonnet EEG sur la tête. Elle place un casque audio sur ses oreilles – pour communiquer avec elle – et une manette dans chacune de ses mains. Un miroir au-dessus des yeux de Fiona, connecté à un écran de télévision, affichera les exercices à refaire durant la séance d’IRM fonctionnelle, pendant laquelle sera enregistrée l’activité de son cerveau. Le corps de la jeune femme coulisse dans le tunnel qui se referme sur elle. La séance démarre par une courte séquence anatomique pour imager la structure du cerveau: la matière grise (le corps des neurones) et la matière blanche (les « câbles » recouverts de la myéline qui assure la conductivité électrique). Le volume de ces structures, qui détermine le bon fonctionnement cérébral, diminue au cours du vieillissement.
Ensuite, l’opératrice demande à Fiona de se détendre, afin d’enregistrer son cerveau au repos. Du moins le lui fait-on croire. En réalité, deux ronds rouges s’affichent à quelques minutes d’intervalle. Elle devra a posteriori estimer cette durée, ce qui permettra de mesurer comment la mémoire enregistre spontanément le temps. » En général, les personnes plus âgées sous-estiment les durées. Si cela se confirme, Times aura validé cette différence comportementale avec les plus jeunes », commente Thomas Hinault.
La séquence fonctionnelle peut continuer: Fiona va refaire les exercices appris sur ordinateur. En couplant les deux techniques, IRM plus EEG, avec un casque haute densité, Thomas Hinault s’attend à un résultat inédit. « Pendant l’exécution d’une tâche, nous parvenons à enregistrer simultanément le ‘quand’ par EEG – l’activité électrique des neurones, avec leur rythme et leur synchronisation – et le ‘où’ par IRM fonctionnelle – la consommation d’oxygène des régions du cerveau, y compris des zones profondes. Nous pouvons donc savoir quelles zones cérébrales s’activent et à quel moment elles se synchronisent lorsqu’on se rappelle une durée, par exemple. Cela n’a jamais été fait pour le temps. » Si l’expérience (qui s’achèvera dans trois à quatre ans) révèle des différences statistiquement significatives entre les jeunes et les plus âgés, ce sera une preuve que le cerveau vieillissant se réorganise pour mémoriser le temps.
La séance IRM est presque finie. Fiona enlève son casque EEG dans la salle voisine et retourne s’allonger dans l’appareil, dont la puissance a été augmentée pour deux dernières séquences anatomiques: l’une concernant la perfusion cérébrale, destinée à constater comment le sang envoyé par le cœur irrigue le cerveau, mesure utile pour évaluer la diffusion du radiotraceur lors de la future séance de PET-scan ; l’autre pour tracer le réseau de fibres de matière blanche qui connecte les régions entre elles et qui s’affine souvent avec l’âge.
Après un moment de détente, la jeune femme rejoint le bureau de Léa Coquerel à l’unité 1077 pour la dernière partie de la séance, un bilan neuropsychologique d’une durée d’une heure et demie. Elle passe une série de tests (attention, mémoire de travail, maintien de l’information) puis répond à un questionnaire portant à la fois sur son statut socio-économique (paramètre qui influe sur les capacités cognitives) et sur sa santé mentale. « On cherche à évaluer la présence de symptômes dépressifs: souvent, ces derniers s’accentuent avec l’âge et donnent l’impression d’un allongement du temps », précise Thomas Hinault.
Les chercheurs espèrent trouver des marqueurs de la mémorisation du temps
Une semaine plus tard, Fiona revient à Cyceron, à jeun cette fois, pour la seconde séance. Christelle Lebouleux l’accueille dans la salle de perfusion, où elle lui injecte un radiotraceur à base de fluor, la Fdopa, à raison de 2 mégabecquerels/kg. Fiona doit alors attendre quatre-vingt-dix minutes dans la salle d’injection, afin que le produit se diffuse jusqu’à son cerveau. Elle en profite pour relire son dernier cours de droit constitutionnel.
Puis Christelle l’accompagne dans la salle de PET-scan. L’étudiante s’allonge, la tête dans l’appareil dont les capteurs de radioactivité vont enregistrer, pendant trente minutes, où se fixe le radiotraceur dans son cerveau et avec quelle intensité. L’image obtenue en temps réel montre une fixation intense autour des deux striatums, régions situées dans les profondeurs du cerveau. Pour Thomas Hinault, ce n’est pas vraiment une surprise: « Le striatum est fortement innervé en neurones à dopamine, le neurotransmetteur que nous visualisons avec le traceur. Selon une hypothèse assez débattue, le striatum fonctionnerait comme un chronomètre qui encoderait la durée des événements. Nous cherchons à le vérifier et à voir si la neurotransmission de dopamine diminue avec l’âge, ce qui expliquerait la modification de notre rapport au temps. » Fiona sort de la salle de PET-scan. Comme elle est encore un peu radioactive, elle reste dans ce côté du bâtiment pour terminer le bilan neuropsychologique entamé une semaine plus tôt avec Léa Coquerel.
Pour Fiona et les plus jeunes, l’expérience Times s’arrête à ces deux séances. Les plus âgés reviendront en revanche une fois par an pendant trois ans pour un suivi plus léger, afin de voir si leurs performances évoluent avec le temps. Ils répéteront uniquement l’exercice des trois tâches sous EEG et repasseront le bilan neuropsychologique. Quel que soit leur âge, tous devront attendre quatre ans avant de connaître les résultats. Pour Thomas Hinault, le jeu en vaut la chandelle: « Nous espérons trouver des marqueurs cérébraux et cognitifs de la mémorisation du temps qui nous permettront aussi d’évaluer la perte d’autonomie avec l’âge « , conclut-il avec enthousiasme.
Après un cancer du sein, l’oubli guette
À l’unité 1077, la professeure de neuropsychologie Bénédicte Giffard s’intéresse aux effets sur la mémoire de l’hormonothérapie que reçoivent, pendant cinq à dix ans, 70 % des femmes traitées pour un cancer du sein, afin de prévenir une récidive. Elles se plaignent souvent de troubles de la mémoire prospective, celle qui nous rappelle de faire les choses au bon moment, par exemple prendre un médicament à telle heure. « Pourtant, leurs résultats aux tests de mémoire standard sont généralement normaux », relève la chercheuse.
Pour tester cette mémoire perturbée, Bénédicte Giffard a imaginé un protocole très original qui s’est déroulé dans la salle immersive du Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle (Cireve) de l’université de Caen Normandie. Équipées de lunettes 3D, les volontaires ont été plongées dans la visite virtuelle du Mémorial de Caen. Elles devaient exécuter à des moments précis neuf actions apprises dix heures plus tôt. « Leurs résultats étaient moins bons que ceux de témoins sans pathologie. Leur mémoire prospective était donc perturbée par l’hormonothérapie » , constate Bénédicte Giffard, qui précise: « Si l’on intercale une nuit de sommeil entre la mémorisation des actions à faire et la visite virtuelle, leurs résultats s’améliorent, tout en restant inférieurs à ceux des témoins. Le sommeil ne suffit donc pas à gommer les effets de l’hormonothérapie. »
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press