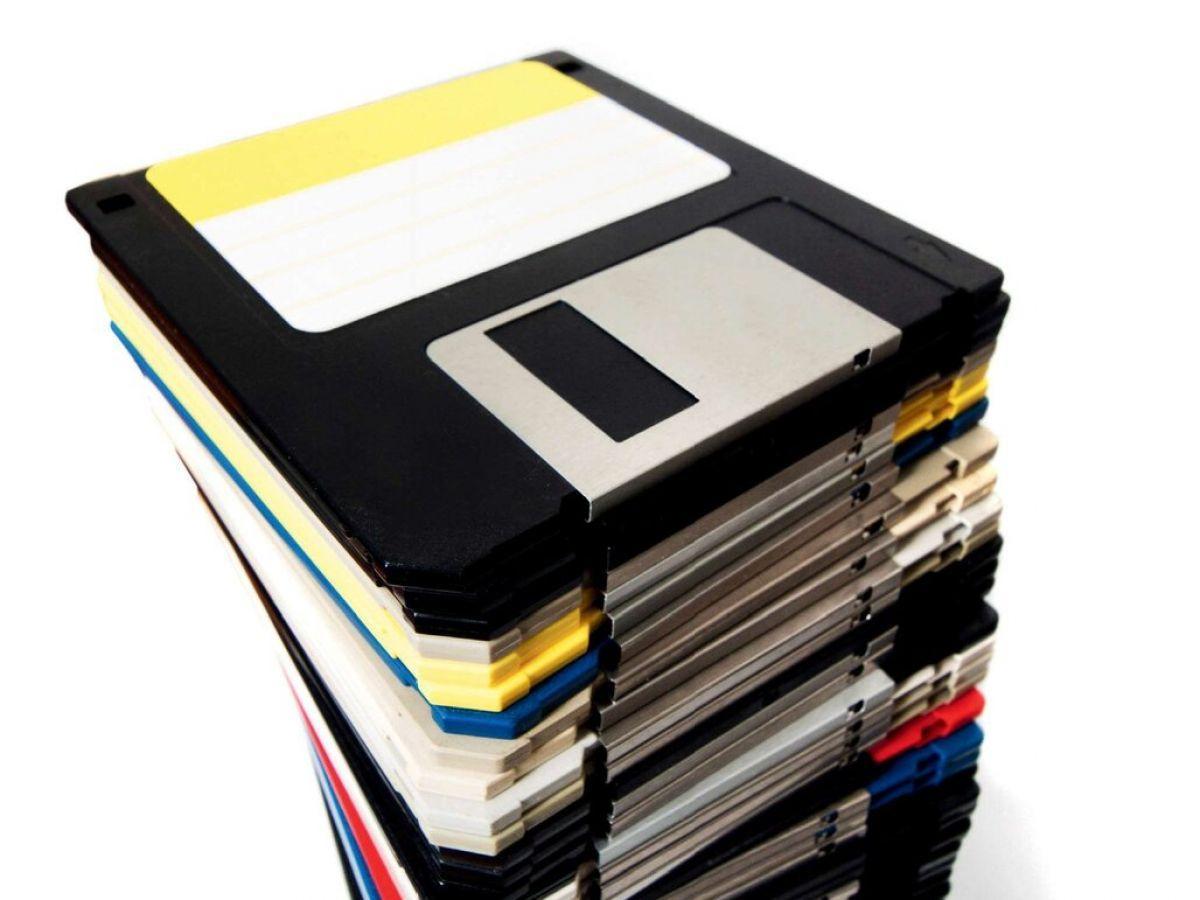Africa-Press – Côte d’Ivoire. Contrairement à la mémoire humaine, malléable, émotionnelle et souvent imprécise, les mémoires numériques, essentielles à nos sociétés connectées, stockent et restituent les informations de manière précise, neutre et fidèle. C’est bien avant l’informatique que sont apparues les premières formes de mémoire binaire.
Dès le début du 19e siècle, en effet, les cartes perforées du métier Jacquard ont permis de coder de l’information: un trou ou l’absence de trou indiquait si un fil devait être levé ou non avant le passage de la navette, définissant ainsi la valeur d’un « pixel » du motif en cours de tissage.
La DRAM, la mémoire qui peut aussi tout oublier
Le même principe est à l’œuvre dans les cartes perforées utilisées par l’ingénieur Herman Hollerith pour le recensement américain de 1890, puis dans la carte à 80 colonnes brevetée par IBM en 1928, qui fut le support central de la mécanographie, en quelque sorte l’âge de bronze de l’informatique. Avant même l’électronique, de nombreuses machines électromécaniques – trieuses, perforatrices, interclasseuses, tabulatrices – furent inventées pour le traitement automatisé de certaines données: comptabilité, statistiques, recensements… La carte à 80 colonnes restera comme une icône de l’informatique jusqu’au début des années 1980.
Mais pour se développer, l’ordinateur avait aussi besoin d’un autre type de mémoire, capable de ranger et retrouver rapidement les résultats intermédiaires des calculs: la mémoire centrale. Une mémoire à accès direct (RAM pour Random Access Memory), par opposition aux mémoires à accès séquentiel: on ne peut lire la énième carte perforée qu’après avoir lu la n-1… Dans les années 1950, les mémoires à tores magnétiques font leur apparition, permettant de stocker des bits de données à l’aide de petits anneaux de ferrite (une céramique ferrimagnétique) aimantés dans un sens (pôles nord et sud) ou dans l’autre. Robustes, rémanentes (elles préservent leur contenu sans alimentation électrique), elles régnèrent pendant une vingtaine d’années sur la jeune informatique.
Puis vint l’ère des puces, du silicium: la DRAM (Dynamic RAM) apparaît en 1970. Chaque bit y est incarné par un minuscule condensateur, chargé ou non. Mais il finit toujours par se décharger et il faut donc « rafraîchir » ce type de mémoire toutes les quelques millisecondes. La DRAM a beaucoup de qualités, mais en l’absence d’alimentation électrique, elle oublie tout…
Increvables, non volatiles et miniaturisables
Pour le stockage à long terme, on parie sur le magnétisme. C’est avec l’ordinateur Univac I, en 1951, qu’apparaît le premier lecteur-enregistreur de bande magnétique, capable de stocker un peu plus d’un mégaoctet sur 365 mètres d’une bande à l’époque métallique. Vous avez bien lu: 365 mètres pour un mégaoctet. Support de stockage séquentiel, mais amovible, la bande magnétique reste le mode d’archivage ultime. Ce sont aujourd’hui des téraoctets (milliers de gigaoctets) qu’elle sauvegarde, à l’abri de cartouches manipulées dans des dispositifs robotisés accumulant des pétaoctets (millions de gigaoctets).
En 1956, c’est à nouveau IBM qui lance le premier disque magnétique, offrant cette fois un accès direct aux données. Il répartit environ 5 mégaoctets sur 50 plateaux de 60 centimètres de diamètre tournant à 1.200 tours par minute sur un même axe. On stocke aujourd’hui des téraoctets sur des disques de 3,5 pouces (9 cm) et même 2,5 (6 cm). Toute la littérature francophone tiendrait sur un disque actuel !
C’est encore IBM qui lance en 1962 la première unité de stockage à disque amovible, et en 1971 le premier lecteur de disquettes. Ce support très économique jouera un rôle essentiel dans l’essor de l’informatique personnelle. À partir de 1982, la révolution optique prend le relais: un faisceau laser grave et détecte d’infimes cuvettes dans un disque en polycarbonate. CD, DVD puis Blu-ray ont successivement véhiculé nos musiques et nos films, avant d’être supplantés par… internet.
Dans les années 1990 apparaît notamment le SSD (Solid-State Drive), en quelque sorte un disque sans pièce mobile, contenant des puces de « mémoire flash », où chaque bit est stocké sur un transistor possédant une « grille flottante » capable de retenir une charge électrique à l’abri d’une couche isolante d’oxyde de silicium. Ces dernières années, les SSD ont connu une explosion de performances, avec notamment des temps d’accès de quelques microsecondes et une consommation énergétique très réduite, pour un coût toujours à la baisse. Mais, talon d’Achille, la mémoire flash fatigue à l’usage: chaque bit ne peut être réécrit qu’un nombre limité de fois, par exemple 100.000. Ce qui complexifie sa gestion.
Aujourd’hui, dans les laboratoires, les pistes pour la mémoire du futur se multiplient. On envisage des mémoires « universelles » qui seraient à la fois plus rapides que la DRAM, non volatiles, increvables, miniaturisables et économiques au point de pouvoir remplacer nos disques et SSD. La MRAM (Magnetic RAM) représente chaque bit par l’orientation relative du champ magnétique de deux couches ferromagnétiques séparées par une fine couche isolante. La mémoire à changement de phase (PCM pour Phase Change Memory) s’appuie quant à elle sur des matériaux capables de passer rapidement de l’état amorphe (désordonné) à l’état cristallin (ordonné) sous l’effet d’impulsions thermiques. La FeRAM (Ferroelectric RAM) est en quelque sorte de la mémoire DRAM à laquelle on a ajouté une couche ferroélectrique pour obtenir la non-volatilité. Enfin, la ReRAM (Resistive RAM) joue sur la création et la rupture de filaments conducteurs au sein d’un matériau isolant.
La MRAM offre rapidité et endurance, mais sa fabrication reste coûteuse et sa miniaturisation délicate. Plus dense, la PCM consomme beaucoup d’énergie à l’écriture. La FeRAM, rapide et économe, souffre d’une miniaturisation encore limitée. Quant à la ReRAM, promise à une forte densité et à une faible consommation, elle doit encore surmonter des obstacles techniques, notamment en matière de fiabilité et de répétabilité.
Quand l’une de ces technologies atteindra une maturité autorisant une production massive à bas coût, un nouveau type d’ordinateur devrait émerger, où mémoire vive et mémoire de stockage ne feraient plus qu’une. Un terrain de jeu idéal pour toute application nécessitant un accès immédiat à des données massives. Notamment les réseaux de neurones, lesquels incarnent un nouveau genre de mémoire artificielle, qui ne se contente pas de stocker, mais mémorise en apprenant, à la manière de notre cerveau.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press