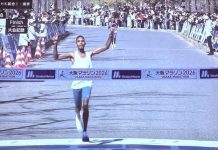Africa-Press – Djibouti. S’il existe encore bien des questions concernant les pyramides d’Égypte, celle de leur localisation à l’orée du désert vient de trouver une réponse lumineuse dans une étude publiée dans la revue Communications Earth & Environment. L’équipe américano-égyptienne à l’origine de cette découverte démontre en effet qu’une ancienne ramification du Nil bordait alors les 31 pyramides situées entre Licht et Gizeh, sur une distance de 64 kilomètres.
Différentes hypothèses sont envisagées pour expliquer la disparition de cette branche, surnommée « branche Ahramat » (littéralement, « branche des pyramides »), et le déplacement du cours du Nil vers l’est au fil du temps. Mais la présence de sédiments fluviaux et les traces laissées dans le sous-sol, lisibles par plusieurs techniques d’imagerie et différentes méthodes géophysiques, attestent indéniablement de son existence, laissant deviner une tout autre géographie des lieux à l’époque de la construction des nécropoles, entre 2700 et 1700 avant notre ère environ.
L’écart entre ces deux paysages emblématiques de l’ancienne civilisation égyptienne se voit ainsi comblé, indice de leur indissociabilité, puisque c’est grâce à ce bras que les pyramides ont pu être érigées.
Il y a 4000 ans, les pyramides d’Égypte se trouvaient au bord du Nil
La construction des premiers complexes pyramidaux, telle la pyramide à degrés du pharaon Djoser, remonte au début de l’Ancien Empire, il y a environ 4700 ans. Si l’on parle de complexes, c’est que les nécropoles royales se constituent de plusieurs structures: devant la pyramide se trouve un temple mortuaire, relié à un deuxième temple situé plus bas dans la vallée par une longue chaussée inclinée, servant de passage cérémoniel.
Entre l’Ancien Empire et la Deuxième Période intermédiaire (qui succède au Moyen Empire), c’est-à-dire entre la IIIe et la XIIIe dynastie, 31 pyramides ont été construites au sein de plusieurs nécropoles: Licht, Dahchour, Saqqara, Abousir et Gizeh, qui se succèdent, du sud vers le nord, le long d’une ligne correspondant actuellement à une bande de terre à l’extrême ouest du désert. Au-delà commence la vallée du Nil, dont le cours est distant de 2 à 10 kilomètres.
Modifications de la vallée du Nil au cours des derniers millénaires
On connaît les caprices du Nil, ses crues qui fertilisent le sol tout en entretenant des marécages propices à la diffusion d’épidémies. Non seulement son lit est fluctuant, mais c’est toute la vallée du fleuve qui a connu de fortes modifications au cours des derniers millénaires. Entre 14.500 et 5000 ans avant notre ère, la région du Sahara oriental a connu de très fortes précipitations, le désert est devenu une savane arrosée par des lacs et de grands fleuves.
Au cours de cette période dénommée « période humide africaine », le Nil avait un débit élevé qui rendait sa plaine peu propice à l’habitat. Avec la fin de la phase humide, il y a environ 7000 ans, l’aridité du Sahara a poussé les humains à quitter la savane pour investir la vallée du Nil, en s’installant dans les zones surélevées de la plaine d’inondation, résultat de la sédimentation des terres autour d’anciens chenaux. Au début de l’Ancien Empire, les premières pyramides ont ainsi été construites en bordure de cette plaine d’inondation. « À cette époque, précisent les chercheurs, le débit du Nil était encore considérablement plus élevé qu’aujourd’hui, ce qui lui a permis de conserver de nombreuses ramifications qui serpentaient dans sa plaine inondable. »
Déplacement du cours du Nil
La situation paradoxale dans laquelle se trouve la recherche se voit ainsi exprimée: on sait que le Nil jouait un rôle central, puisqu’il s’agissait alors du « principal couloir d’eau ». On sait qu’il a servi à transporter les matériaux nécessaires à la construction des villes et des monuments, et c’est pour cette raison que ces villes et monuments se trouvent à proximité de ses rives. Mais il manque encore « une compréhension globale du Nil à l’époque de l’ancienne civilisation égyptienne », c’est-à-dire de sa morphologie dans le détail et de sa dynamique, car « au fil du temps, le cours principal du Nil a migré latéralement et ses bras périphériques se sont ensablés, mais on ne sait toujours pas exactement où se situaient les anciens cours, ni si ses différents tronçons avaient un seul ou plusieurs bras simultanément actifs dans le passé ».
En résumé: si aujourd’hui de nombreux sites antiques sont éloignés du cours actuel du fleuve, il y a fort à parier que lors de leur construction, leur chaussée cérémonielle aboutissait à un port au bord d’un bras du Nil. Il ne reste plus qu’à le prouver !
Plusieurs types d’analyses pour sonder le sol
Plusieurs études ont déjà été menées par différentes équipes pour localiser des segments de l’ancien cours du Nil, mais les recherches sur le terrain sont difficiles car l’ancienne plaine d’inondation du fleuve est aujourd’hui comblée par des couches de limon et de sable et recouverte par l’activité anthropogénique.
Quelques sections ont tout de même été identifiées autour de l’ancienne ville de Memphis, dans le delta du Nil, et près de Louxor, plus au sud ; en 2022, c’est une ancienne rivière, avec un marécage, qui ont été détectés près du plateau de Gizeh. Il s’agit cependant de données fragmentaires, tandis que la présente étude entend obtenir des résultats bien plus larges en recourant à des techniques plus performantes.
Les chercheurs recourent ainsi à la télédétection par satellite, la géomorphologie, la géologie et la géophysique pour dresser « la première carte du cadre paléohydrologique dans la région de Licht à Gizeh » et mettre en évidence la présence de l’ancienne branche Ahramat.
L’imagerie radar révèle d’emblée le chenal
La première technique utilisée: l’imagerie radar, obtenue à partir des données du satellite Sentinel-1 de l’Agence spatiale européenne (ESA), fournit déjà les preuves de l’existence de sections d’une ancienne ramification de rivière tout le long des 31 pyramides. Cette ramification, qui se situe aujourd’hui entre 2,5 et 10,25 kilomètres à l’ouest du Nil, s’étend sur 64 kilomètres de long ; sa profondeur varie entre 2 et 8 mètres et sa largeur entre 200 et 700 mètres. Le Nil actuel connaissant les mêmes fluctuations de largeur, cela signifie que la branche Ahramat était « une voie d’eau fonctionnelle d’une grande importance », affirment les chercheurs.
D’autres techniques de détection sur le terrain
Sur le terrain, le radar à pénétration de sol (GPR) et la tomographie électromagnétique (EMT) révèlent à leur tour la présence d’un chenal situé entre un mètre et un mètre et demi de profondeur sous la plaine d’inondation du Nil, aujourd’hui recouverte de champs cultivés. Pour le confirmer encore, l’équipe procède à deux carottages qui mettent en évidence la présence d’eaux souterraines peu profondes.
Les pyramides sont alignées sur la rive de la branche Ahramat
Une fois reconstitué le cours de la branche Ahramat, les chercheurs constatent que de nombreuses chaussées cérémonielles sont non seulement perpendiculaires à l’ancien cours d’eau, mais qu’elles s’achèvent précisément sur sa rive. Cette position correspond précisément à la fonction des temples bas situés à l’extrémité de ces chaussées, puisqu’ils servaient de ports où l’on débarquait matériaux et visiteurs.
Dans la mesure où les cinq temples bas ayant subsisté datent de périodes différentes, l’équipe peut également retracer les fluctuations du niveau de la « branche des pyramides » pendant environ un millénaire, entre l’Ancien Empire et la Deuxième période intermédiaire (2649-1540 avant notre ère).
Les données radar montrent, en 3D, une expression topographique claire d’un segment de l’ancienne branche Ahramat dans la plaine d’inondation du Nil, à proximité du plateau de Gizeh. Les chaussées des quatre pyramides mènent à un bras, que les chercheurs ont dénommé « bras de Gizeh », qui se connecte à l’ouest avec la branche Ahramat. Ces segments de rivière sont invisibles sur les images satellites optiques car ils sont masqués par les terres cultivées de la plaine inondable du Nil. La photo montre le temple bas de la pyramide de Khéphren. Crédits: Eman Ghoneim / Ghoneim et al., 2024 / Communications Earth & Environment
Plusieurs hypothèses pour expliquer l’assèchement de cette ramification
Au fil du temps, le niveau de l’eau a non seulement évolué, mais la branche s’est progressivement déplacée vers l’est avant de s’assécher. Cette modification de son cours est confirmée par le fait que les pyramides du Moyen Empire ont été érigées plus à l’est et à une altitude moins élevée que celles de l’Ancien Empire.
Plusieurs hypothèses sont envisagées: l’activité tectonique aurait pu faire basculer le delta du Nil vers le nord-est ; le sable éolien en provenance du désert a probablement envasé la branche du fleuve, ce qui est d’ailleurs corroboré par l’enfouissement de plusieurs sites (à Abousir par exemple) sous plusieurs mètres de sable ; une diminution des précipitations – confirmée par une période attestée de sécheresse pendant la période intermédiaire entre l’Ancien et le Moyen Empire – a également contribué à réduire le débit et à envaser la branche Ahramat.
Signification de cette découverte
Au-delà de la seule explication de l’étrange éloignement des pyramides par rapport au cours actuel du Nil, la mise en évidence de la branche Ahramat est riche de signification sur le plan archéologique. Les chercheurs indiquent en effet que des sites enfouis encore inconnus ont sans doute été construits le long de ce bras actif pendant l’Antiquité, et qu’il s’agit dès à présent d’envisager de les retrouver pour pouvoir les fouiller. La zone autour de cette ancienne ramification devrait donc être protégée de l’urbanisation galopante.
Enfin, il paraît évident que d’autres bras du Nil se sont pareillement éteints et que leur cours est aussi à retracer. Ce qui nous laisse deviner combien la plaine du fleuve recèle encore de trésors à découvrir et à protéger.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Djibouti, suivez Africa-Press