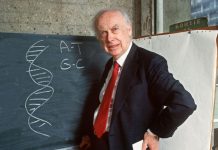Africa-Press – Burkina Faso. Les épidémies mortelles ont-elles joué un rôle majeur au cours de l’Antiquité, au point de dépeupler des villes entières? Ce scénario a par exemple été proposé pour la ville d’Akhetaton (aujourd’hui dénommée Amarna), créée par le pharaon Akhenaton en plein centre de l’Égypte en 1346 avant notre ère, qui aurait été désertée environ quinze ans plus tard, peu après son décès. Les historiens qui ont avancé cette thèse se sont appuyés sur des sources textuelles mentionnant une peste venue d’Égypte, et des maladies dans la région.
Pour vérifier ces dires, deux chercheuses du Projet Amarna ont examiné les restes de près de 900 squelettes inhumés dans l’ancienne capitale égyptienne, sans y trouver quelque indice d’épidémie, ni aucun autre marqueur décelable au sein des nécropoles ou de la ville. D’ailleurs, si la population a bien diminué après le départ de la cour royale, la ville est restée habitée. Akhetaton n’aurait donc pas été subitement abandonnée à la suite d’une épidémie, ce qui contredit la légende qui lui reste attachée.
Akhetaton, capitale éphémère de l’Ancienne Égypte, n’a pas été abandonnée à cause d’une épidémie
Nombre de narratifs historiques impliquent des événements catastrophiques – invasions, destructions ou épidémies mortelles – sans nécessairement se fonder sur des preuves autres que des témoignages ou des textes anciens, dont la fiabilité et la véracité peuvent être remises en cause. Il est donc plus que jamais nécessaire de revisiter ces narratifs à la lumière des découvertes archéologiques, une tendance actuelle dans la recherche, qui permet de rétablir la réalité des faits ou, tout du moins, d’y tendre. Ce principe est ici appliqué à la légende entourant la ville d’Akhetaton (l’Horizon d’Aton), érigée sur une terre vierge en Moyenne Égypte, par le pharaon Akhenaton (Aménophis IV, 1379 ou 1372-1336 avant notre ère).
Le siège du pouvoir pendant seulement 15 à 20 ans
La capitale dédiée au culte d’Aton fut le siège du pouvoir pendant environ quinze à vingt ans, la famille royale l’ayant quittée au début du règne de Toutânkhamon, quelques années après le décès d’Akhenaton. Ce départ a d’abord fait croire que la ville avait été totalement désertée ; plusieurs événements et sources textuelles ont ensuite laissé entendre qu’elle avait été touchée par une épidémie.
Certains membres de la famille royale sont en effet morts en peu de temps, alimentant les suspicions, mais, comme l’expliquent les deux auteures dans l’American Journal of Archaeology, « bon nombre de ces décès ont des causes plausibles non épidémiques », car il s’agissait soit d’enfants en bas âge, soit de femmes sans doute mortes de vieillesse ou en couches.
Des prières contre la peste dans l’empire hittite
Ces décès ont été mis en relation avec des prières contre la peste découvertes sur des tablettes hittites évoquant une épidémie survenue à la fin du 14e siècle. Elle aurait été propagée par des prisonniers de guerre égyptiens, capturés dans la plaine de la Beqaa (au Liban actuel) et aurait frappé l’empire hittite (en Anatolie) pendant une vingtaine d’années. Mais il reste difficile d’identifier la maladie en question, ni ce qui l’a causé, et encore moins si elle venait vraiment d’Égypte, car « aucune preuve textuelle, archéologique ou paléopathologique concluante n’y a encore été identifiée pour des épidémies généralisées à la fin de l’âge du bronze ou à d’autres périodes », soulignent les auteures.
Fouilles dans quatre cimetières d’Akhetaton
Pour vérifier s’il y a eu une épidémie à Akhetaton, il est possible de se tourner vers les preuves bioarchéologiques – à savoir les restes squelettiques des anciens habitants. Plusieurs sortes de nécropoles sont présentes sur le site, dont quatre cimetières destinés à la population dans son ensemble, et non à l’élite. Même si les tombes ont été perturbées par des pillages, ce corpus représente « l’un des ensembles de données les plus importants dont on dispose à ce jour sur l’ancienne Égypte ». Les chercheurs qui ont procédé aux fouilles entre 2005 et 2022 estiment que près de 13.000 personnes y ont été enterrées, mais les inhumations exploitables se chiffrent à 889.
Des corps abîmés par le labeur
Dans un premier temps, il s’agit de chercher des signes de maladie épidémique, mais les squelettes portent surtout les marques de « charges de stress importantes » (petite taille à l’âge adulte, traumatismes de la colonne vertébrale, maladies articulaires dégénératives), indiquant que les défunts étaient majoritairement des ouvriers. Certaines maladies peuvent être identifiées, comme la lèpre, la syphilis ou la tuberculose, mais la plupart ne laissant pas de lésions squelettiques, il est impossible de connaître l’étendue réelle des pathologies dont ont souffert ces personnes.
D’autres facteurs sont susceptibles de trahir la présence d’une épidémie urbaine
Pour identifier un facteur épidémique, il faudrait recourir à des analyses d’ADN ancien, ce qui n’a pas encore été possible à Akhetaton. Les chercheuses se tournent ainsi vers d’autres caractéristiques pouvant signaler la présence d’une épidémie en milieu urbain. Des travaux précédents ont en effet montré que des modifications sont alors introduites dans les pratiques funéraires et la construction, sans oublier les profonds changements dans le taux de mortalité et la démographie en général. Mais l’examen de ces quatre caractéristiques ne fournit aucun élément concluant en faveur de la présence d’une épidémie à Akhetaton.
Les pratiques funéraires restent respectueuses des morts
En effet, les chercheuses ne constatent aucun changement dans le traitement des morts: il n’y a pas de fosses communes, ni de dépôts isolés, ni de corps semblant avoir été enterrés à la va-vite sans soin aucun. La plupart, non embaumés mais enroulés dans un tissu et dans une natte avant d’être déposés dans leur cercueil, étaient enterrés avec un modeste trousseau. Là où l’on détecte une divergence – des inhumations multiples dans une même tombe –, des explications autres que l’épidémie sont possibles: des mères enterrées avec leur enfant, des groupes familiaux, ou de très jeunes ouvriers (enfants et jeunes jusqu’à 25 ans) qui ont dû succomber suite à une charge excessive de travail. Mais toutes ces inhumations ne portent aucun signe de précipitation ni de désordre.
La ville n’a pas été complètement désertée
L’abandon assez rapide de la ville indique-t-il qu’une épidémie y a sévi? Non, car « les vestiges archéologiques donnent l’impression que la ville a été abandonnée de manière ordonnée, laissant aux habitants le temps de rassembler et d’emporter leurs biens », répondent les chercheuses. En réalité, cet abandon n’est même pas total, ni aussi soudain qu’on l’a laissé entendre. Non seulement l’État va continuer à y mener certaines activités pendant plusieurs décennies après la mort d’Akhenaton, mais la ville ne cesse pas de croître à ce moment précis. Les preuves archéologiques suggèrent qu’une population assez importante serait restée en ville, en déplaçant progressivement le centre-ville vers le quartier méridional dit du temple fluvial.
Aucune trace de crise démographique
La démographie peut également trahir la présence d’une épidémie, mais en se basant sur la population inhumée dans les cimetières, sur l’espérance moyenne de vie et sur la durée d’occupation de la ville, aucune crise démographique n’est décelable. Il est notable que cette population compte peu d’enfants en bas âge et peu de personnes âgées, mais ce schéma « atypique pour un environnement urbain préindustriel n’est pas nécessairement dû à une épidémie », constatent les chercheuses, qui le mettent en relation avec la particularité d’Akhetaton.
Il s’agit en effet d’une ville éphémère, peuplée par une population venue d’ailleurs et dont une fraction l’a ensuite quittée. Il est donc logique qu’une partie des familles ait été enterrée ailleurs, soit dans leur ville d’origine, avant leur installation à Akhetaton, soit dans leur ville de destination, après leur départ.
Comment se forment les faits et comment ils doivent être établis
En l’état actuel de la recherche, rien n’indique donc qu’il y ait eu à Akhetaton une épidémie responsable d’un fort taux de mortalité, ni de l’abandon de la ville. Mais pour en être absolument certains, il faudra procéder à des analyses d’ADN ancien, concèdent les chercheuses.
Cette étude démontre ainsi combien les spécialistes de l’Antiquité peuvent parfois fonder leurs écrits sur des indices plus que ténus, et combien il est nécessaire de les questionner et de mener des recherches au niveau local au lieu de penser l’ancienne Méditerranée comme un espace global. Certes, les fouilles sur le terrain n’apportent que des informations qui semblent au premier abord limitées, elles ne permettent pas de brosser un vaste tableau à l’échelle internationale, mais elles sont au moins fiables.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Burkina Faso, suivez Africa-Press