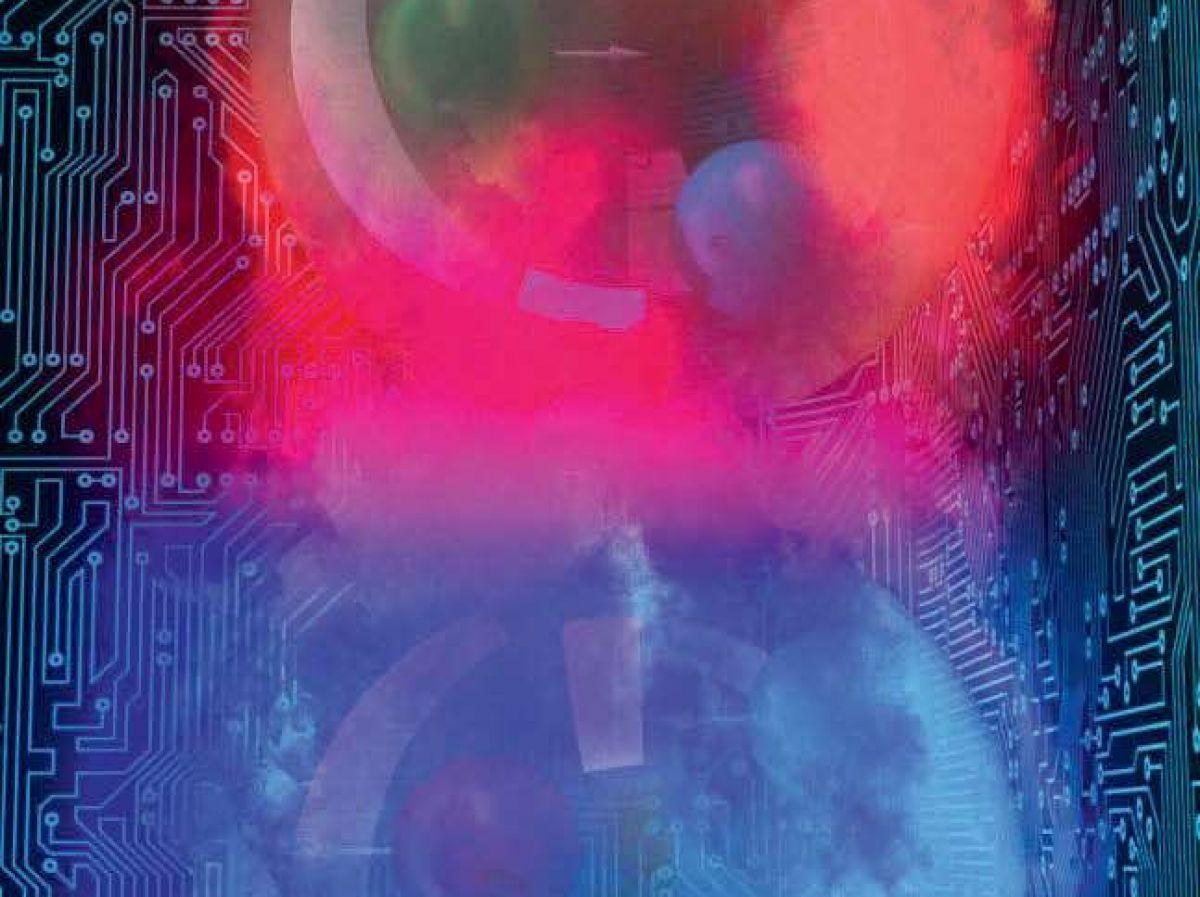Africa-Press – Burkina Faso. C’est une taille qui compte, et qui fait débat. Combien mesure le rayon d’un proton ? Cette particule constitue, avec le neutron, le noyau des atomes et se trouve ainsi au cœur de la matière.
Un rayon de 0,84 femtomètre
Jusqu’en 2010, la valeur admise pour son rayon, issue de mesures expérimentales, était de 0,88 femtomètre (10^-15 m). Puis une série d’expériences utilisant une autre méthode fit pencher la balance vers 0,84 femtomètres. Comme nous parlons de millionièmes de milliardième de mètres, la différence pourrait paraître insignifiante. Erreur ! Un tel écart en physique des particules n’est pas raisonnable. Certains y voyaient déjà une brèche dans le modèle standard, ce bel édifice décrivant l’ensemble des particules et leurs interactions.
Mais non. Des scientifiques de l’université de Mayence (Allemagne) viennent d’ajouter une pierre à l’édifice de la mesure du proton, en l’abordant par la face théorique. En maniant une kyrielle d’équations complexes, ils ont fini par trouver 0,84 femtomètre (fm), confirmant les dernières mesures. Le proton serait donc bien un peu plus petit que ce que l’on a cru pendant longtemps…
Un nuage chargé d’électricité
Mais de quoi parle-t-on exactement lorsque l’on évoque le « rayon » d’une particule qui n’a que peu à voir avec une sphère « en dur », type balle de ping-pong ? Il doit plutôt être vu comme une sorte de nuage chargé électriquement, sans bord net. Mais il devient globalement moins dense à mesure qu’on s’éloigne de son centre. Ce que l’on appelle son rayon, ou plus exactement son « rayon de charge », correspond à la distance à partir de laquelle cette densité de charge électrique devient négligeable.
Mesurer son rayon revient donc à estimer sa sphère d’influence sur une particule chargée en quelque sorte. Ce qui donne une méthode pour l’obtenir : utiliser une particule chargée comme sonde. Ainsi, la première technique utilisée consistait à bombarder le proton avec des électrons, des particules élémentaires, bien plus petites que le proton, chargée négativement. C’est en déterminant à partir de quelle distance les électrons sont perturbés dans leur trajectoire par la présence du proton que l’on établit la mesure de 0,88 fm.
Muon et laser pour mesurer le proton
En 2010, les physiciens décidèrent d’utiliser une méthode plus précise à base de lasers et de muons, un cousin de l’électron mais 207 fois plus massif. En substituant l’électron qui tournicote autour du proton par un muon, les chercheurs ont fabriqué de l’hydrogène muonique. Ils l’ont ensuite excité par un laser. L’énergie d’excitation est liée directement au rayon du proton élevé au carré. Et cette fois, la mesure donne 0,84 fm. Ce n’est pas plus précis que la précédente méthode, c’est carrément différent. Shocking !
Pour trancher, les chercheurs de l’université de Mayence ont donc utilisé le calcul, à partir de la théorie de la chromodynamique quantique (QCD). Elle décrit les interactions à l’œuvre dans le noyau atomique. Les protons sont formés de trois quarks, les éléments constitutifs élémentaires de la matière, et de gluons qui agissent comme des particules messagères de l’interaction forte qui lie les quarks entre eux. A partir de simulations numériques réalisées par des supercalculateurs, les scientifiques de Mayence sont ainsi parvenus à déterminer ce fameux rayon, l’estimant à 0,84 fm.
Si cela valide avec éclat les expériences délicates menées avec les muons, les théoriciens ne pourront s’empêcher d’être déçus car cela souligne une fois de plus l’excellence du modèle standard de la physique des particules. Or, il faudra bien un jour le prendre en défaut si l’on veut expliquer la matière noire, ou l’énergie noire, constituants majoritaires de l’Univers, et dont le modèle standard ne dit rien…
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Burkina Faso, suivez Africa-Press