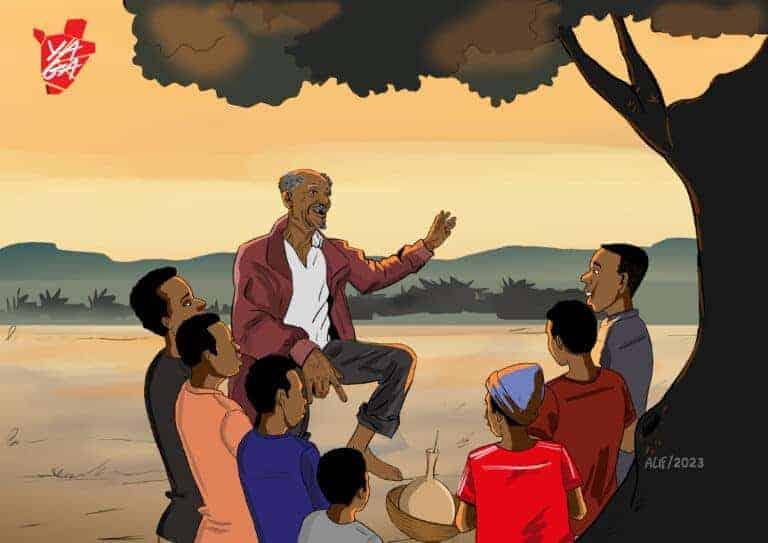Africa-Press – Burundi. Pas mal de gens ont tendance à confondre l’histoire et mémoire. Pourtant, dans le cadre de la justice transitionnelle, ces deux expressions sont loin d’être des synonymes. En s’inspirant du cas du Burundi, notre blogueur nous montre la dépendance de deux expressions et nous révèle que nous ne pouvons pas avoir l’une sans l’autre.
Actuellement, le Burundi est engagé sur la voie de la justice transitionnelle. Par les travaux de la CVR, il est beaucoup question de la mémoire et du passé. Cependant, il y a lieu de se demander : et l’histoire dans tout ça ? En effet, la tentation est toujours grande de réduire la mémoire à un simple objet de l’histoire, au risque de la dépouiller même de sa fonction matricielle.
Ceci étant, la mémoire n’est pas l’histoire, bien que les deux expressions soient souvent utilisées comme des synonymes. Le passé dont s’occupe l’historien est trop complexe et plus grand que la mémoire dont nous en avons. Surtout, le passé est à reconnaître comme tel et c’est le propre de l’activité de l’historien que de poser le passé comme passé. Mais la mémoire faisant objet de l’histoire, prend le statut, non d’un simple objet parmi tant d’autres de l’histoire, mais elle est comme la matière première de l’histoire. Elle est comme le vivier d’où puisent les historiens. Ainsi, en tenant compte d’une variété de sources de l’histoire, il peut se construire un passé qui échappe de loin à la mémoire (dont personne n’a pu se souvenir).
C’est pour cette raison que l’histoire a cessé d’être « partie de la mémoire » et que la mémoire est devenue « partie d’histoire ». (P. RICOEUR, la Mémoire, l’histoire, l’oubli, P.506). Ici, l’exemple est clair : la mémoire de la guerre civile qu’ont les Burundais est différente de l’histoire de la guerre civile au Burundi. Certes, trouver le rapport entre mémoire et histoire n’est pas une question anodine surtout que parmi les missions de la CVR, il y a celle de proposer la réécriture d’une histoire plus partagée par tous et l’érection des sites ou monuments de la réconciliation et de la mémoire.
Existence d’un grand vide historiqueLes différentes crises que le Burundi a traversées sont désormais des références pour l’histoire sombre du Burundi. Pourtant, elles n’ont pas toujours suscité le même intérêt auprès des chercheurs tant nationaux qu’étrangers. Cette situation a ouvert l’existence d’un grand vide historique qui n’a été rempli que par des versions des faits émanant parfois des auteurs amateurs ou des acteurs politiques, dont la première motivation n’était pas nécessairement la recherche de la vérité.
Selon l’enquête de CENAP en 2019 « BURUNDI aperçu historique des crises politico ethniques à travers des enquêtes : de l’indépendance à 1994 », il n’existe pratiquement pas de publications scientifiques sur la crise de 1965. Augustin Mariro a publié en 2005, Burundi 1965 : La 1ère crise ethnique, Genèse et contexte géopolitique, Paris, l’Harmattan, 2005. Elle est la seule référence disponible. Il en est de même pour les crises de 1972 et 1988 pour lesquelles les publications sont très rares en dehors de celles relevant essentiellement de l’amateurisme.
La mémoire est une reconstructionL’exemple le plus évident se trouve dans le cas des meurtres de masse perpétrés par les nazis et les fascistes dans les camps de concentration entre 1933 et 1945. Cet évènement tragique est considéré comme l’un des plus sombres de l’histoire et il est toujours associé à la formule, désormais adoptée comme un slogan, « Plus jamais ça ! ». Le devoir de mémoire ici joue un rôle fondamental dans la construction du chemin de l’histoire future.
La mémoire est comme le jugement qu’un groupe ou un individu peut porter sur le passé, car il doit affronter un passé encore présent, actif, tenu pour sensible. Ce qui est en jeu n’est pas seulement le souvenir, déjà si fragile, de quelqu’un qui a vécu tel événement. C’est aussi le jugement de la postérité, de ceux qui n’ont pas vécu ce dont ils parlent, mais qui se sentent engagés par ces événements sur lesquels ils n’ont eu aucune prise.
Malheureusement, les crises burundaises ont été différemment vécues selon la composante à laquelle on appartient et du rôle lui attribué. Au cours de l’histoire récente du Burundi, les désaccords des différents acteurs aux conflits burundais, ont conduit à la mise en place des mémoires plurielles dont les positions ont changé au gré des circonstances. Ceci dit, l’une et l’autre se transforme en mémoire forte ou faible selon les forces politiques en place.
La mémoire au service de l’histoireLa mémoire historique est le chemin et la forme par lesquels nous nous rappelons des faits passés. L’histoire, quant à elle, est un témoignage des évènements passés qui ont été jugés comme étant les plus pertinents, et non un témoignage neutre. Ainsi, ce que nous attendons de l’histoire, c’est l’objectivité. Un lien de complémentarité doit obligatoirement être assuré en considérant la mémoire comme une relecture des évènements (histoire) et de la manière dont nous les avons vécus. De cette manière, comprenons que les conclusions auxquelles peut parvenir un historien sont souvent nuancées, incomplètes susceptibles d’être manipulées et déformées, mais malheureusement de façon volontaire, alors que la mémoire peut subir une déformation et être soumise à la manipulation, et ce, de façon inconsciente.
Pour conclure, l’essentiel ne se trouve pas dans la priorité de l’histoire ou de la mémoire, mais dans le soin qu’on prendra de découvrir leur relation de complémentarité et de réciprocité mutuelle, dans laquelle la mémoire conservera la fonction matricielle par rapport à l’histoire.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Burundi, suivez Africa-Press