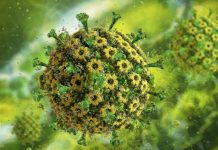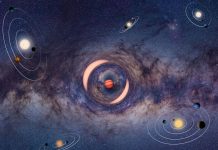Africa-Press – Burundi. La souffrance non exprimée et non reconnue, produite par des traumatismes divers, peut déboucher sur des comportements déviants. Une anthropologue, lectrice et blogueuse de Yaga, ayant séjourné et travaillé plusieurs fois au Burundi relate ses observations et réflexions sur la souffrance chez les Burundais.
« Merci de revenir et m’aider à me sentir plus tranquille à chaque fois ». Ainsi nous a remerciés une dame que nous (mes traducteurs et moi) avons interviewée plusieurs fois dans le camp des déplacés de Bugendana, au centre du pays. Le camp a commencé à être construit en 1994 pour regrouper et offrir un refuge aux Tutsi qui avaient fui leurs maisons sur les collines après l’assassinat du Président Ndadaye en 1993. C’est à Bugendana que j’ai collecté une partie des interviews que j’ai conduites dans le cadre de ma recherche doctorale sur « nous » et « eux » dans le Burundi contemporain (ma thèse doctorale, en Anglais, peut être consultée ici). Dans ma recherche, j’ai analysé le sentiment d’appartenance à l’ubwoko des Abahutu ou des Abatutsi, dans la définition de « nous » et « eux », dans trois localités (Bugendana, Gasunu et Mugara, dans les provinces de Gitega et Rumonge) qui ont été marquées par des épisodes importantes de violence entre Hutu et Tutsi en 1972, 1993 et 2002. Plus précisément, j’ai analysé les facteurs favorisant l’émergence d’un sentiment d’appartenance très fort à son groupe, ce qui augmente la distance entre le groupe d’appartenance et les « Autres », ainsi que les facteurs facilitant le rapprochement entre « nous » et « eux ». J’ai travaillé dans ces trois localités pendant 12 mois entre 2018 et 2020. Trois ans après, en mai 2023, je suis allée visiter les gens qui m’ont aidée dans ces trois localités pour leur montrer le livre que j’ai écrit, ce qui a été possible aussi grâce à ce qu’ils m’ont raconté. Je les ai remerciés pour cela et pour m’avoir ainsi permis d’avancer dans ma carrière.
La plupart des gens étaient très contents de nous revoir. Avec certains, un lien relativement fort s’était créé lors de notre interview, raison pour laquelle notre réapparition à trois ans de distance a provoqué de la joie. Plusieurs m’ont dit qu’ils ne s’attendaient pas à ça et que c’était une belle surprise ; quelques-uns, en me voyant revenir, s’attendaient à une grosse somme d’argent ; d’autres ne se souvenaient plus de quoi on avait parlé. Une personne m’a demandé comment j’ai fait pour survivre à la Covid-19, qui a fait rage chez les Blancs. Tous m’ont couverte de remerciements et bénédictions et souhaits de bonne chance.
Les portes du passé cachent bien des souffrancesParmi toutes, la réaction de la dame dont je reporte la phrase au début de cet article m’a particulièrement touchée. J’ai été deux fois chez elle, et à chaque fois l’interview s’est déroulée de manière très bizarre. La première fois, je sentais une forte résistance de la part de la dame au début et tout au long de l’interview, ce qui me demandait d’avancer avec précaution et de respecter ses silences. En nous donnant des mots au compte-gouttes, la dame nous raconta les violences vécues en 1993, la perte de son mari et son déplacement de sa colline, vers Kibimba d’abord et puis à Bugendana. Elle versa quelques larmes quand elle nous dit qu’elle n’aurait jamais pu penser à se remarier après avoir perdu son mari. Vers la fin de l’interview, le petit-fils de la dame parut à la porte, dans son uniforme scolaire beige lavé, pour chercher quelque chose qu’il avait oubliée en allant à l’école. L’enfant arriva en courant, il s’arrêta à la porte surpris de trouver des inconnus, parmi lesquels une muzungu (je suis rarement appelée muzungukazi au Burundi), chez sa grand-mère. Cela cassa l’atmosphère tendue de l’interview. La dame se concentra sur l’enfant, lui donna ce qu’il cherchait, réarrangea son uniforme et lui peigna les cheveux. Tout se passa dans le silence. Une fois prêt, l’enfant partit pour l’école et sa grand-mère le regarda s’éloigner, debout à côté de la porte, le regard loin et rempli d’amour. C’était une belle scène. Dans la tentative de consoler la dame après qu’elle nous avait accompagnés dans les violences de son passé, je lui dis qu’elle avait un bel enfant et que c’était bien que, malgré les pertes du passé, elle avait des petits-enfants aujourd’hui qu’elle pouvait chérir.
À ce moment-là, la dame changea brusquement d’attitude et décida de tout nous raconter. Elle nous dit l’horreur de la manière dont son mari avait été tué, les menaces envers elle, les mauvaises relations avec ses anciens voisins sur la colline, l’assassinat de son fils, après celui de son mari, lors de l’attaque au camp de Bugendana en 1996. Cette fois-ci, la dame ne versa pas de larmes ; il y eut seulement une avalanche de colère et frustration qu’elle a vomie sur nous. Je restai pétrifiée, d’abord en voyant sa réaction radicalement changée, puis quand mon traducteur m’expliqua ce que la dame était en train de dire (j’aurai toujours un respect énorme pour les traducteurs qui m’ont accompagnée sur le terrain, et j’admirerai toujours leur capacité de rester détachés et me traduire ce que les gens me racontaient sans y glisser un commentaire ou une émotion). Nous restâmes tous les trois en silence pendant un moment. Personnellement je ne savais pas quoi dire, et je me sentais d’ailleurs extrêmement coupable pour avoir demandé à la dame de m’ouvrir la porte vers son passé de souffrance. Je lui dis que je m’excusais d’avoir posé mes questions et que ce n’était pas du tout mon intention de la faire souffrir encore. (Ne m’en voulez pas : ceux qui ont accepté de répondre à mes questions l’ont fait volontairement et après avoir été rassurés qu’ils pouvaient éviter de répondre aux questions qui les mettaient mal à l’aise ; moi-même je changeais de sujet quand je sentais que l’atmosphère devenait trop tendue et l’interviewé.e devenait réticent.e, et je n’ai insisté avec aucune personne pour avoir des détails sur ce qui s’était passé. Mais je suis convaincue que parfois, comme dans le cas de la dame dont je parle, les émotions reviennent, en masse, furieuses, prisonnières depuis des années et impatientes de sortir de là où on les a repoussées et cachées pendant longtemps. Et quand cela arrive, c’est tellement fort et rapide que même la personne qui les a éprouvées, et les éprouve à nouveau, n’est pas en mesure de les contrôler. Sur cela, l’interlocuteur n’a pas de contrôle non plus.)
À ma grande surprise, la dame me remercia ! Elle me dit que par contre c’était une bonne chose de parler de ce qui s’était passé – elle ne m’expliqua pas pourquoi, mais je présuppose que cela lui avait permis de se libérer d’un poids ; du moins, c’est la sensation que j’avais quand nous échangeâmes nos derniers mots après la bourrasque, puisqu’elle nous parlait de manière beaucoup plus détendue.
L’écoute, une étape fondamentaleQuand nous nous revîmes dans le camp, j’eus l’impression qu’elle m’évitait – de manière peut être inconsciente, je représentais désormais pour elle un rappel de la souffrance qu’elle avait vécue. Quand nous commençâmes notre deuxième interview, elle restait encore un peu distante, pour se détendre par après, petit à petit, question après question. Quand je l’approchai lors de ma dernière visite pour lui demander si nous pouvions échanger quelques mots, elle nous répondit qu’elle n’était pas la personne que nous cherchions ; elle nous donna même un faux nom, avec un petit sourire au coin des lèvres. Pour moi, c’était impossible d’oublier son visage. Une fois à la maison, je lui expliquai la raison de ma visite et lui montrai mon livre. Elle fut contente et nous remercia même « pour l’aider à se sentir plus tranquille à chaque fois ».
Ce n’était pas la raison pour laquelle j’étais venue au Burundi, d’organiser des sessions de psy à domicile (d’autant plus que je ne suis pas une psychologue et je n’ai pas reçu l’éducation me permettant de suggérer à mes interlocuteurs comment gérer leurs émotions), mais c’est ce que j’ai souvent eu l’impression de faire, avec plusieurs des personnes que j’ai interviewées. D’un côté, cela questionne la manière dont plusieurs chercheurs (moi j’en étais une) approchent « le terrain », sans connaitre réellement les enjeux psychologiques de la recherche, notamment les charges émotionnelles des interviewés ainsi que celles des chercheurs et du public potentiel des résultats de la recherche. Mais surtout, cela souligne le besoin criant de beaucoup de Burundais ayant souffert lors des différentes crises que le pays a vécues d’exprimer leur souffrance, de l’expulser de leurs corps, de la faire entendre, et d’être écoutés.
L’écoute, surtout, est une étape fondamentale : seulement par l’écoute, la souffrance peut être passée à quelqu’un d’autre et ainsi expulsée de son corps. Cela est déjà une étape révolutionnaire – je pouvais le voir dans l’attitude de la dame dont j’ai parlé et de celle de beaucoup d’autres personnes comme elle. Seulement après s’être libérés de sa souffrance, du moins de sa partie la plus douloureuse, on pourra être disponible à écouter la souffrance de l’Autre. Seulement après avoir vidé son cœur d’une partie de sa souffrance on pourra être prêt à recevoir une partie de celle de l’Autre. Sans l’étape de l’écoute, il n’y aura que dialogue entre souffrants, chacun trop absorbé par sa propre souffrance pour imaginer que les autres puissent avoir aussi réellement souffert. Ainsi, tout effort dans la direction de la « réconciliation » sera vain, puisque la souffrance, et avec elle, la rancune, resteront dans les cœurs des gens. Ce n’est pas une pasteure qui vous le dit mais une anthropologue qui a parlé avec beaucoup de gens que je dirais traumatisés.
Cette réflexion ne regarde pas seulement les souffrances de ceux qui ont vécu et ont été lourdement affectés par les violences de 1993 ou 1972. Cela regarde tout type de souffrance existant dans la société contemporaine – soit-elle liée aux violences du passé entre Tutsi et Hutu, ou pas. L’épisode du ‘fou’ qui criait sa colère au monde à 4h du matin n’est qu’une autre démonstration de ce besoin criant d’exprimer sa souffrance. Probablement ivre et en dérangeant tout le voisinage, chiens y compris, ce crieur a tout de même essayé d’expulser de la souffrance – du moins, il a montré qu’il avait ce besoin.
Je crois qu’il est temps d’écouter ces souffrances, si on ne veut pas une société de plus en plus souffrante.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Burundi, suivez Africa-Press